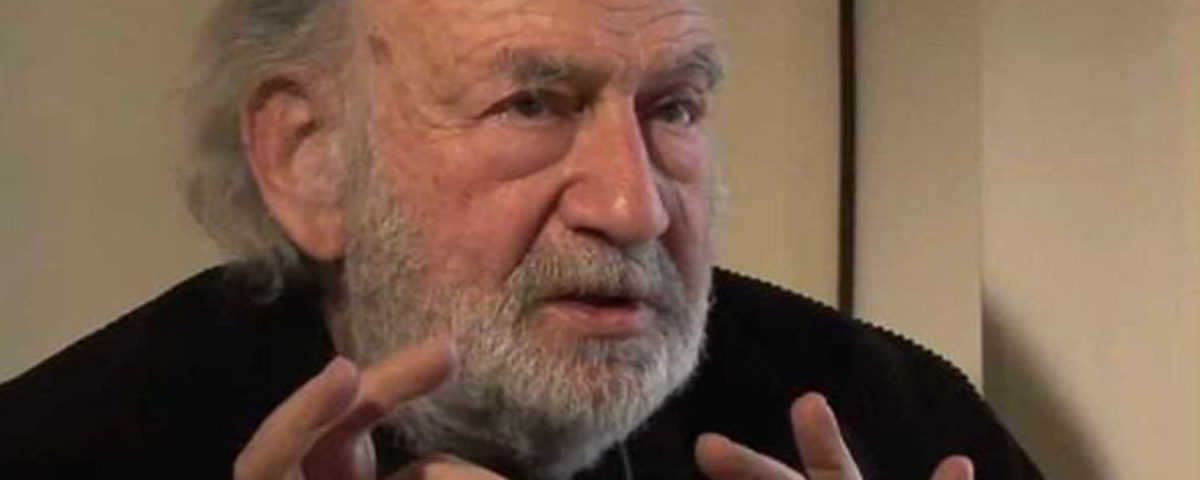Livre : De la pensée aux projets
Article,
10 mai 2019
1. Positionnement
Transversalité, le regard décalé
L’engagement, l’architecte citoyen
L’éthique, la recherche de sens
“Le futur de l'homme, comme homme, repose sur la renaissance du dialogue"
"The future of man as man depends upon a rebirth of dialogue”
Martin Buber, The Way of response

Habiter le monde et le rendre habitable...
S'impliquer, manipuler, inventer, et être acteurs engagés de notre environnement
et de notre quotidien.
Introduction
Face aux personnes avec lesquels j’interviens, je demande souvent comment ils se positionnent, dans leur vies professionnelles, citoyenne, politique.
Parallèlement, je leurs communique aisément « là où j’en suis ». Ce texte peut en témoigner.
Nous occupons la terre comme si elle nous appartenait, comme si elle était inépuisable, aussi bien dans l’utilisation que nous faisons de ses ressources que dans l’occupation de sa surface. Nous nous conduisons comme des prédateurs d'une terre dont nous sommes les hôtes et qui constitue notre patrimoine commun.
Que pourrait exprimer le sens de notre civilisation, pas celle de la mondialisation économique, mais celle d’un humanisme de ressources partagées, respectueuses d’une terre qui nous est léguée, et que nous avons la responsabilité de sauvegarder pour les générations futures.
Nous pourrions avoir l’impression que la mondialisation est récente. En réalité, chaque grande civilisation, quel que soit l’époque, visa l'hégémonie : mésopotamienne, égyptienne, grecque, romaine, islamique, Ce colonialisme culturel, économique, stratégique, politique, cette expansion vers l’Ouest, le Sud et l’Orient a précédé dans le temps, mais pas dans la forme, les tentatives d’aujourd’hui, de maintenir des secteurs d’influences économiques et politiques.
La prise de conscience est rude, et nous vivons amèrement ce retour de boumerang, par les populations qui pendant des siècles, ont vécu nos envahissements et dominations.
Cette colonisation d’une nation par une autre, qui ne prend pas nécessairement la forme d’une occupation physique. Bien plus occulte, elle peut suivre d’autres chemins, culturels, économiques, virtuelles. Elle existe également dans chacun de nos pays sous la forme d’une ségrégation sociale et économique qui touche la vie quotidienne, de la métropole vers les régions, de l'urbain vers le rural.
Sur un plan personnel, j’ai directement vécu et un peu compris ces formes de pouvoir, apparentes ou occultes sur trois continents, aux États-Unis, en Inde et en France.
Le processus de fragmentation d’une culture sur une autre, phénomène que toutes les civilisations ont imposé ou subi tout au long de leur histoire, devient aujourd’hui global. Nous en prenons conscience d’une sournoise hégémonie : culturelle, économique, de modes de vie et de pensée, consciente, ou inconsciente
Elle s’infiltre dans les moindres recoins de notre environnement, surtout par les réseaux sociaux, et entraine une "dégradation" de langages, écrits, visuels, parlés. Disons plutôt une simplification, une compression influencée par les technologies de la communication, elles-mêmes aux mains d’un petit nombre.
Dans la langue parlée, la simplification des codes oraux et de la gestuelle symbolique est un phénomène plus lent, incessant, souvent inconscient mais également irréversible. Cette diminution de vocabulaire peut s'infiltrer aussi dans bien notre manière de raisonner, de penser que dans notre relation à l’autre, au sensible, à l’intime.
Dans chaque domaine, il existe des formes de pensée dominantes ; une pensée unique, qui marginalise toutes les autres idées possibles sans qu’elles soient pour autant divergentes ou dissidentes, et qui peut s’accompagner d’un bruitage de sujets mineures
Dans l’urbanisme opérationnel, cette même dérive consiste à répondre aux besoins immédiats, à cette même présence de non-lieux, de non relations, d’où toute pensée architecturale, pensée de « projet et non d’objets » , est absente, même avec l'aval d’un nombre croissant de professionnels.
Face à la complexité, à l’aspect insaisissable de la croissance de nos villes, certains courants d’architecture s’appuient :
- soit sur un réalisme du quotidien, et y puisent même une sorte d’inspiration pour imaginer la ville du futur. Cette tendance remonte à la fin des années 50, et se réfère à "Learning from Los Vegas" de Robert Venturi sur l’architecture commerciale, les bâtiments en forme de poulet, de hamburger, de saucisses,
- soit sur une insaisissable complexité technologique ou formelle.
Je suis à l’opposé de ces conceptions, tout comme contre la langue de bois qui affirme des certitudes non étayées par l’expérience et le vécu, les doubles langages qui gravitent autour de la notion de démocratie en nous donnant l’illusion de pouvoir penser et agir librement, d’être en possession de nos choix de paroles, de modes de vie, d’habitats...
Je ne crois pas à la frénésie actuelle d’expressions visuelles, trop rapidement conçues et soutenues par commercialisation de tout. Je ne crois pas davantage que puisse survivre, la juxtaposition d’individualismes qui caractérise l’époque, et qu’elle soit porteuse d’un avenir dans lequel les valeurs de sociabilité, pour penser l’autre, pour penser aux autres, en la recherche de biens communs.
Comment pourrions-nous mieux prendre en compte la dimension éthique d’habiter la terre et de vivre ensemble lorsque nous devons penser l’extension de nos communes, l’intercommunalité, le devenir urbain du monde ? Nous sommes tous concernés par ce que Louis Kahn appelait “l’esprit de l’architecture”, par la création de lieux et d’espaces qui respirent, qui vibrent, qui sont inspirés et qui à leur tour inspirent ceux qui aujourd’hui ou demain habiteront, ou seulement côtoieront ces lieux et ces espaces.
L’espace public devrait pouvoir inclure aussi des lieux symboliques, des lieux « signifiants » pour accueillir les populations qui ne s’identifient pas nécessairement aux lieux de culture officiels…Je pense souvent à l’Inde où il y a une multitude de ces lieux, souvent très simples, comme sous ces grands arbres, dont l'es énormes tronc et feuillage protègent de minuscule autels colorés et fleuris.
L’architecture, la pédagogie et des démarches participatives.
Ce sont trois mondes, dont les intentions et les réflexions se croisent, et s’interpellent. L’architecture est intimement liée à un territoire, à un terroir. Ceci implique une population spécifique, que impérativement on se doit de prendre en compte, d’interroger et de comprendre. Sans élitisme de ma part, de sensibiliser à la recherche d’une réelle identité individuelle et collective. Il s’agit de contrebalancer la domination et l’hégémonie du toujours plus, afin de questionner et tenter de se dégager de la manipulation des pouvoirs par les médias, les relais administratifs et notre propre aliénation.
C’est ainsi que de part et d’autre : « maîtres d’ouvrages », élus habitants nous pouvons espérer devenir de réels interlocuteurs, et ensemble façonner des environnements qui correspondraient mieux à nos valeurs et une éthique de territoire partagée.
La formation, s'impliquer, manipuler
Tous les lieux, toutes les situations ont une potentialité de formation d'interrogation et d’innovation. Les écoles maternelles sont exceptionnellement vivantes et particulièrement inventives. On y rentre avec joie. Mais à partir de là, dès l’école primaire, et tout ce qui suit y inclus l’université, et bien évidemment les écoles d’architecture, on se trouve d’après ma propre expérience dans des mondes démunies de vie, qui valorisent l'abstraction et l'intellectualisation au détriment des expériences vécues, manuelles et tactiles.
Certes il y a maintenant médiathèques et ordinateurs. Mais on tente tout de même d’y valoriser ce qui est intellectuel au sens de ce qui est mental, au détriment du sensible. Des ateliers de fabrication, d’invention, des outils, des pratiques artistiques, des technologies allant des vieux tracteurs à des éoliennes et panneaux solaires, sans négliger l’entente avec la nature, une bassecour, un potager, pourrait si facilement coexister et participer à la « pédagogie ».
Que de plus triste en France, que certaines de ces écoles d’architecture isolées et souvent en dehors de la cité. Elles, qui pourraient se retrouver au sein d’universités de l’environnement, réunissant toutes les matières et disciplines qui collaborent à la fabrication de nos territoires, de nos villes et villages, au milieux agricoles et naturels.
En continuant d’intensifier la séparation entre l’intellectualisation et le faire, le virtuel et le réel, le monde clos de la formation et celui de la vie en marche, nous sommes comme des générations en retard. Il en résulte une intolérable perte de connaissances, de synergies, d’imaginations, et de relations sociales…
En Inde et en France, j’ai participé a des expériences de formation ou les étudiants en architecture, côtoient d’autres disciplines dans un contexte spécifique de village, de quartier en contact avec des élus et les habitants. Dans des ateliers publics d’architecture et d’urbanisme ce travail sur le terrain, en alternance avec l’école dérangeait souvent d’autres enseignants, qui sont souvent plutôt confortablement retranchés dans un savoir plus théorique à une distance confortable du terrain.
Je rêve toujours de voir se réaliser un tel atelier dans le « Pays Cœur d’Hérault ». Un lieu de rencontre : du monde universitaire, des préoccupations des habitants, de la formation permanente, et de recherche action autour de l'identité d'un territoire.
C’est ainsi que nous avons crée « la Distillerie » en 2017 à Lodève dans l’Hérault , un tiers lieu qui rassemble divers créateurs, artisans, concepteurs.
L'arbre qui cache la forêt
Je pense très humblement, qu'en à peine deux générations, culturellement et économiquement, nous sommes devenus aliénés de ce qui étaient juste alors les fondements de notre environnement. La mondialisation dominée par les manipulations économiques, que l'on retrouve au quotidien dans la grande distribution, remplace nos savoirs faires. On aurait tendance à ne produire nous-même pratiquement plus rien de nos besoins du quotidien.
Dès les années mille neuf cent vingt, Gandhi avait signifié que la domination étrangère passait par la domination de l'économie de quotidien. Les populations devenaient ainsi aliénées, perdaient leur identité, devenaient totalement dépendantes. La résistance passive, la « marche pour le sel », la réintroduction du tissage dans les villages, comme d’autres métiers artisanaux ou agricoles sont autant de témoignages de cette vision.
Recherche d'identité... vers la pratique de démarches participatives.
Aussi bien dans l'enseignement qu'en architecture ou dans la vie associative, les démarches participatives sont importantes. La participation n’est pas « une couche en plus » que l’on rajoute à un projet. C’est une véritable démarche en tant que tel, que l'on peut retrouver aussi bien dans l'enseignement, dans la pratique, que dans le domaine associatif.
Voici quelques exemples.
- l’étude recherche action « Participation in Community » effectuée en 1968 dans des villages du Goujarat en Inde, où nous avons pu séjourné plus d’un mois sur place avec des étudiants, en répertoriant ce qui donne du sens à la vie villageoise, puis de présenter les résultat aux habitants et ne partir comme des voleurs avec l’information pour en faire une thèse.
- une démarche similaire dans les années 70 /80, en contact quotidien avec les habitants, dans le cade de l’école d’architecture 8, avec des ateliers dans des villages de la région parisienne.
- le travail dans l’Hérault avec l’association "la manufacture des paysages",
- puis, en retour à Ahmedabad où en 2008 / 2009 nous avons réalisé un travail pluridisciplinaire au sein de l'université de CEPT une recherche sur les 400 kilomètre de la rivière Sabarmati puis une exposition au cœur du marché le plus populaire de la ville.
Dans le domaine de l'architecture :
Des projets d’habitats participatifs tel le Buisson Saint Louis à Paris X, puis en HLM locatif Gennevilliers, Yzeure.
Dans le champ associatif :
Depuis presque vingt ans, dans l’Hérault, je me suis dirigé progressivement vers des implications citoyennes, d’abord comme élu dans la petite commune de Villeneuvette, puis avec l’association « la manufacture des paysages », que nous avons re baptisé en « manufacture des pays ».
C’est à partir de Villeneuvette, ancienne manufacture royale du XVII siècle, véritable bijou entouré de champs, que j’ai éprouvé un sentiment de responsabilité vis à vis du monde environnant.
Comme élu, come architecte, il me paraissait d’autant plus important de pouvoir valoriser un tel exemple de cohérence urbaine vis à vis des communes environnantes déjà partiellement détruites par d’étalement urbain qui déstabilise le fragile équilibre du tissu rural entre le bâti et les activités artisanales, économiques et agricoles.
Depuis 2002, l’association « la Manufacture des Paysages » ,devenue « des Pays », tente de sensibiliser les élus, habitants, et bien évidemment les jeunes, à penser une urbanisation territoriale cohérente. Penser, puis essayer de créer, dans un environnement dominé par l’hégémonie marchande de pertes de valeurs et d’identité.
Après 14 années de travail, l’association à du clôturer son exercice. Elle a été reconduite en 2017 comme « Manufacture des Pays » plus orientée vers le travail auprès des jeunes et l’action de tissage.
Puis, « la Distillerie », expérience en cours d’un « tiers lieux » , à Lodève, à 50 kilomètres à l’ouest de Montpellier, où se pratiquent différentes activités culturelles, artisanales et artistiques, comme l’atelier de tissage, l’atelier de la main.
La place du "politique"
L’urbanisme, et l’architecture sont totalement inséparables du politique et de la politique.
Comment peut-on imaginer uniquement parce que l’on vous le commande, de participer à la fabrication de ces zoos architecturaux urbains en France et ailleurs, des absurdités écologiques de tours isolées les unes des autres et qui ne sont qu’une révérence en plus au pouvoir et à l’argent. Et avec une certaine désinvolture sans se soucier qu’il existe à peine à quelques centaines de mètres d’incroyables pauvreté.
Nous ne pouvons pas ainsi accroître les inégalités sociales.
L’architecture est spatiale, mais elle est aussi infiniment et intimement sociale.
Elle est intimement liée à l’éthique et au sens d’un monde auquel nous souhaiterions pouvoir participer.
Être architecte
Je visualise un axe de vie « passé présent futur », une liane autour de laquelle s’articulent ce qui m’a été transmis », avec la mémoire de plus d’une génération de parents et grands-parents juifs laïcs, mais les expériences de jeunesse, puis ma vie personnelle et professionnelle, mon engagement en tant que citoyen, de pédagogue, dans la recherche le l’expression d’une éthique.
C’est de tenter de miser sur une recherche du sens et du beau. C’est la responsabilité de pouvoir sauvegarder et de contribuer autant qu’il m’est possible, à la recherche d’une cohérence de notre environnement, et à l’amélioration de la vie quotidienne des habitants.
C’est d’avoir conscience, comme pouvait le dire Pierre Rabhi, que si la terre avait une voix, elle hurlerait son désespoir…
Ceux vers qui je suis reconnaissant
Gandhi, Martin Luther King, Paolo Freire, Ivan Illich, puis Patrick Geddes qui reste pour moi cet incontournable visionnaire comme pour moi Georges Nakashima, architecte puis, puis « woodworker,... et Louis Kahn architecte de recherche de sens, pédagogue, et crèateur de projets inoubliables. Des penseurs comme Martin Buber, Dom Elder Camara, de Pierre Rabhi, E.F. Schumacher, et dans notre domaine de Louis Kahn, Aldo Van Eyck, et plus relié à notre travail dans l’Hérault, les contributions d’Alberto Magnaghi (« le village urbain »), et David Manguin.
Mais jamais je ne peux oublier tous ces incroyables artisans d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs, des hommes dont les revues en général ne parlent pas.
Au Palais de Justice de Montpellier, à l’entrée j’ai moi même financé, pour cause d’une incompatibilité politique de la part du procureur, une grande plaque avec plus de six cent noms des ouvriers ayant travaillé sur le chantier.
Sans eux, il n’y a pas d’œuvre. Cette reconnaissance, c’est aussi une forme de participation.

2. La pédagogie
de la pédagogie active à l'université militante
Texte de présentation : le rêve des structures d’interface, l’université à passerelles, théorie et pratiques de terrain, alternance recherche-action.
Expériences pédagogiques : USA, Inde, France
Maison de Ville
“La naissance de l’école... au début, ce fut un homme sous un arbre, un homme qui ne savait pas qu’il était un maître, parlant avec quelques autres qui ne savaient pas qu’ils étaient des élèves. Progressivement l’un d’eux, puis un autre se détachaient et non loin trouvaient d’autres endroits qui leur convenaient...”
Louis I. Kahn
La pédagogie : tour d’ivoire le matin, pieds dans la boue l’après-midi
La pédagogie traverse, et elle n’a cessé de traverser tous les aspects de ma vie, personnelle, professionnelle, de citoyen et bien évidemment d’enseignant. J’ai toujours essayé de maintenir cette transversalité.
En fait, je n’avais jamais vraiment envisagé d’enseigner. Je suis plutôt «tombé dedans», peut-être influencé par Louis I. Kahn et sa «présence», ses questionnements lors de mon année «master» passée avec lui à l’Université de Philadelphie au tout début des années soixante.
J’ai toujours pratiqué une démarche qui met en étroite relation une idée abstraite et son application, la pensée et le faire, sous la forme d’un enseignement par alternance: “tour d’ivoire” le matin, “pieds dans la boue” l’après midi… Cette approche m'a semblé préférable à une forme plus classique procédant par ”séquence”, du plus simple au plus compliqué, surtout quand il s’agit de s'imprégner de la complexité de contextes urbains, avec leurs conflits, incohérences, etc.
Cette manière de faire est à l’opposé des principes de l’enseignement en France, qui est essentiellement théorique, linéaire, essentiellement verbal et écrit et le reste jusqu’à la fin du cycle d’études, qu’elles soient secondaires ou supérieures. Dès le collège, il existe une coupure sociale entre apprentissage intellectuel et manuel. L’Université française est cloisonnée, essentiellement organisée par disciplines, sans réelle transversalité ni passerelles de l’une à l’autre, sans véritable implication non plus avec le monde extérieur, le contexte social et politique environnant, et sans communication étroite entre étudiants et enseignants qui sont relativement peu disponibles en dehors de leurs heures d’intervention et n’ont souvent pas de bureaux personnels. Malgré sa réputation, et à part les grandes écoles qui ont un statut particulier et des fonctionnements différents, l’université française est plutôt mal lotie. A Montpellier, par exemple, il existe quatre sites universitaires, droit, médecine, sciences et techniques, arts et lettres, totalement séparés les uns des autres et sans relations entre eux. Quant à l’école d’architecture, elle est indépendante, isolée sur son propre site.
Dans les universités anglo-saxonnes, au contraire, que j’ai fréquentées comme étudiant, puis comme enseignant, puis mis en place, à Ahmenabad, dans ce qui deviendra CEPT toutes les disciplines sont regroupées le plus souvent sur un même campus : sciences humaines, technologiques, sociales, médecine, droit, avec au centre une très grande bibliothèque. Les départements sont dirigés par des “chairmen” qui n’ont pas du tout le statut quasi permanent des "directeurs" d'écoles et de facultés en France.
Cette différence entre un chairman qui est plus un animateur, et un directeur qui dirige, et fondamentale, et bien évidemment, a une influence sur tous les rapports entre le chairman, les enseignants, les étudiants.
Les enseignants ont à leur disposition des bureaux, des salles de réunion, un secrétariat et sont, pour la plupart, facilement accessibles et quasiment ouvert toute la semaine et toute l’année. Les étudiants ont leurs propres lieux de travail, ils “vivent” quasiment sur le campus. Et les deux mondes - enseignant et étudiant se côtoient.
J'ai toujours connu cette ambiance plus informelle et elle a été celle que j'ai pratiqué moi-même.
Dans un département, ou école d'architecture on a une relation assez directe avec les étudiants.
Ma préoccupation a été de pouvoir établir entre les étudiants et moi même, un climat de dialogue qui permet de partager une démarche, un enthousiasme, d’éveiller ou de renforcer leurs sensibilités latentes, plutôt que d'imposer le simple contenu d'un (de mon) savoir à transmettre.
Je pense que tout professionnel intervenant dans l'environnement, qui est à la fois spatial mais aussi hautement social, doit faire l'effort de rechercher et d'exprimer ce qui le motive. Cette pensée devrait aussi pouvoir être évoquée avec des jeunes qui se préparent à devenir architectes.
Je reste préoccupé par leur propre questionnement et je peux les interroger sur leur "projet" personnel, afin le mieux les accompagner, de les aider à faire surgir ce qu’ils ont parfois du mal à exprimer.
Pour certains d'entre vous, ces aspects peuvent, vous paraître trop personnels. Ils me paraissent être à la base d'une pratique professionnelle que l'on souhaiterait, certes fonctionnelle, mais aussi imprégnée d'une éthique et d’une recherche de sens de se qui est signifiant.
Afin de partager avec les étudiants le sens de cette question, il peut m'arriver de parler de ma propre démarche, en dessinant par exemple un arbre avec ses racines et ses branches qui symbolisent d’où je viens, où j’en suis et le vers quoi je me dirige.
Je travaille peut-être plus sur le sens de la démarche que sur la mise en forme proprement dite d'un projet. Cela veut-il dire que la réflexion, les idées qui sous-tendent ma démarche sont plus importantes que le geste architectural, la réalisation proprement dite. Ce sujet reste à creuser.
Avec les étudiants, comme pour moi même, je continue à privilégier aussi bien le raisonnement qui précède notre travail plutôt que la recherche formelle, même si je dois avouer là une certaine contradiction.
Je m'explique. Je parle de sens, de démarche mais en réalité je suis tout autant sensible à la forme, et si mon projet n’est pas suffisamment "beau" à mes yeux, je ne suis pas satisfait. Je suis pris à mon propre piège, ma propre contradiction.
Pratique
Sur le plan professionnel, cette même attitude pédagogique concerne le rapport avec ceux pour lesquels on intervient comme architecte: la recherche de leurs réels besoins qualitatifs, de leurs aspirations, le souci de ne pas prendre un « programme » comme une chose immuable. Le questionnement sur le site, l’environnement social, et le contexte économique et social restent essentiels.
Partir du lieu. Ce lieu influe sur les habitants. Les habitants qui influent sur le lieu. Ce sont ces va-et-vient qu’il faut initier et transmettre, ce principe de l’altérité réciproque, de l’écoute et de l’échange. C'est un concept de Patrick Geddès qui, dès 1960, est devenu pour moi une référence constante dans mon travail, ma réflexion et mon enseignement. J’ai notamment adopté sa trilogie “folk, work, place”, qui consiste à mettre la société, les activités et les lieux en interaction constante. Il faut écouter, mais il faut aussi que les autres entendent ce que l’on dit. C’est à la fois un principe d’architecture et un principe moral. Je suis sans cesse dans ce balancement, dans ma vie, dans mon métier et dans ma façon d’enseigner.
Dans le cadre de mon propre atelier professionnel (et pas toujours nécessairement avec succès), cette démarche de dialogue et de transmission a toujours été présente, tout comme elle l'est dans ma vie de tous les jours, de citoyen, de voisin ou dans la vie associative, où j’essaie d’entretenir cette volonté de communication et d’ouverture à l’autre.
Enseignant à Yale (1961-1962)
En 1961, alors étudiant dans la classe de Master de Louis Kahn, Architecte et pédagogue exeptionnel, à Philadelphie, j’ai fait la connaissance de l’architecte indien BalkrishnasV.Doshi, venu le soliciter et lui proposer son concours pour la conception de l’I.M.T. ( Indian Institute of Management and Technology ) à Ahmedabad. Doshi avait aussi le projet d’y créer une nouvelle école d’architecture. Un an plus tard, j’y participais, mais avant de partir en Inde, j’ai fait une demande d’assistant au M.I.T. (Massachusets Institute of Technology) auprès de Kevin Lynch (l’un des personnages clés sur le plan de l’analyse urbaine), puis à Yale, dans le département d’urbanisme, où il y avait une équipe plus restreinte, et où finalement j’ai été retenu.
A Yale,où j’ai été engagé, j’étais le plus jeune enseignant et j’avais un peu d’appréhension. Alors le directeur du département d’urbanisme m’a soulagé et soutenu en me disant : “soyez simplement vous-même : architecte. N’essayez pas d’être urbaniste. L’urbanisme c’est toutes les disciplines que nous rassemblons ici dans l’équipe d’enseignants ». C’était effectivement le premier fil transversal et fondateur de la trame avec laquelle je tisserais dans les années à venir.
J’ai également donné des cours sur l’histoire de l’urbanisme que je partageais, comme assistant de Christopher Tunnard.
Son approche, plus strictement historique et descriptive ne me paraissait pas aller assez loin, et ne permettait aux étudiants de réfléchir sur le sens même des organisations du passé.
Il m'est apparu important d'en élargir le contenu, en introduisant des réflexions sur la redécouverte des éléments générateurs qui avaient pu être à l'origine et engendrées leurs organisations spatiales.
Je demandais aux étudiants :
- de dessiner, en plan, en axonométrie, les caractéristiques de différentes époques: Athènes, Rome, un bourg au Moyen-Age, et la ville contemporaine,
- puis d’en faire une lecture des éléments les plus signifiants et du “grain” spatial tel le définissait alors Kevin Lynch dans son livre "l'Image de la Ville",
- et dans un troisième temps, de remonter jusqu’aux « institutions » qui avaient pu en être à l'origine, et les valeurs qui sous-entendaient chacune des cultures que nous abordions.
Cette démarche était en fait le résultat d'un croisement entre:
- la réflexion de Louis Kahn sur la naissance et présence du sens des institutions qui précèdent leur matérialisation ("forme and design").
- et celle de Le Corbusier sur les établissements humains. "habiter, travailler, cultiver le corps et l'esprit".
Pour les villes antiques et médiévales, presque unanimement, les étudiants identifiaient et dessinaient sans réelles difficultés les éléments structurants et leurs relations dans un territoire.
L'ordre dans lesquels les dessins évoluaient donnaient aussi des précisons intéressantes:
- tout d’abord les ruelles et les places autour desquelles se regroupaient les lieux de rassemblement, les institutions religieuses, féodales, artisanales, commerciales, puis un grouillement d’habitats, puis les fortifications englobant le tout, avec ses portes, et les relations avec l’extérieur: les faubourgs, les routes, les champs, une rivière, un port.
Les "valeurs" fondatrices, les institutions, les formes urbaines avaient leurs cohérences.
Pour la ville contemporaine, c’était un peu l'angoisse :
- en premier lieu les autoroutes encerclant les villes, des échangeurs, des carrefours desservant des zones commerciales, les hautes tours au centre - hégémonie du pouvoir financier -, et un saupoudrages d’activités, de pavillons disséminés dans les périphéries.
Véritable plat de nouilles de formes totalement aléatoires.
Se posait clairement, pour "nos" villes, la questions des valeurs qui les fondent (Louis Kahn "forme"), puis quelles structures et mise en forme leurs donner ("design") .
La question fondamentale qui se pose : quelle forme urbaine correspond à nos valeurs, et sont-elles celles auxquelles peuvent s'identifier les habitants, et qui peuvent permettre à un jeune d'imaginer ce qu'il peut devenir (Louis Kahn).
Cette année passée à enseigner à Yale m’a aidé à structurer une approche pédagogique que j’ai ensuite expérimentée en Inde de 1962 et puis en France de 1969.
A Yale, j’aurais pu facilement “faire carrière”, mais je n’avais pas envie de porter une veste en tweed ( “a tweed jacket”, symbole de la réussite universitaire de l’époque) puis tout doucement gravir les échelons d'une carrière universitaire.
Je souhaitais plutôt aller dans un pays où l’on pouvait “retrousser ses manches”. J’ai toujours envisagé l’architecture comme un engagement social et pas uniquement comme une recherche spatiale.
L’expérience indienne (1962-1969) - Ahmedabad, ville industrielle et culturelle dans le Gujarat
De l’école d’architecture à l’université C.E.P.T
"Center for Environment, Planning and Technology"
Avec ma femme Ruth et Claudia ; un bébé de trois mois, je suis arrivé en Inde en 1962 à la naissance même de la nouvelle école d’architecture d’Ahmedabad. Pour le jeune architecte que j’étais, Ahmedabad était alors la ville à laquelle on associait alors Le Corbusier, qui y avait construit plusieurs de ses plus beaux bâtiments, invité (comme l’avaient été au même moment une impressionnante panoplie d’autres artistes d’avant-garde alors inconnus en France comme Calder et Merce Cunningham) par deux familles d’industriels du textile et de mécènes qui avaient fait alors la richesse de la capitale du Gujarat :Sarabhan et Karturbhai.
La possibilité de participer au démarrage d’une nouvelle école d’architecture, de travailler en Inde, de pouvoir être partie prenante de la construction de ce pays en voie de développement m’a fait renoncer à une carrière académique peut-être plus sécurisante aux U.S.A., et choisir une voie plus ouverte et en devenir. Nous formions une sorte de troïka avec Balkrishna Doshi, architecte de talent et Rasvihari Vakil, excellent ingénieur.
Au tout début, pratiquement en même temps que l’arrivée des premiers étudiants, j’avais rédigé un programme inspiré là aussi par Patrick Geddes, sur cinq ans, qui devait tous nous guider par la suite. Afin d’éviter l’écueil d’une accumulation de cours, j’ai proposé trois grands "axes". Le terme anglais de "streams", fleuves est plus ouvert :
de part et d'autre :
- science et technologie,
- l’homme et l’environnement,
encadrant:
- les ateliers et "studios" de synthèse.
L’école d’architecture est devenu au fil des ans le C.E.P.T -Centre Universitaire d’Environnement, Planification et de Technologie- regroupant l’école d’urbanisme, de paysage, d’art, d’ingénieurs et d’architecture intérieure. Une institution tout à fait originale, novatrice, dynamique, unique en Inde, plus courante dans les pays anglo-saxons, au nord de l’Europe, aux USA, mais qui n’a pas son équivalent à ce jour en France. Cette approche de l’enseignement de l’architecture au sein d’un centre de formation pluridisciplinaire et dans un contexte universitaire est pour moi le seul projet pédagogique convenable dans un monde contemporain qui ne cesse d’évoluer, de se complexifier et de se détruire. Ainsi y sont formés non seulement de futurs professionnels mais aussi de futurs citoyens, tous confrontés à d’autres disciplines.
Après quatre ou cinq ans, ne me trouvant pas satisfait avec l’orientation de l’école devenu trop axé sur l’architecture formelle qui ne privilégiait pas assez l’approche du terrain et la compréhension de la société indienne, j'ai fait un pas de côté et mis en place un Institut d’Été, avec une quinzaine d’étudiants, Indiens et de l'étranger.
L’institut d’été
Il proposait une «recherche-action», des études comparatives à partir du contact direct avec un milieu, des habitants, une communauté humaine.
La première année, en 1968, Junagadh District, à l’ouest d’Ahmedabad, a été notre terrain d'étude.
On a mis en pratique une démarche pédagogique “participative”, en allant enquêter sur le terrain, trois villages autour d'un gros bourg commercial. Nous avons recueilli des informations sur le mode de vie, l’agriculture, l’économie, la religion, les relations sociales, et avons établi des relevés des groupements et des habitats.
Plus tard, nous sommes revenus sur place avec un dossier très complet qui mettait en relief les enjeux, les éléments “clés” qu’il était important de résoudre dans le cadre d’une réflexion sur l’évolution des villages et apportait des propositions que l’on a soumis aux habitants. Un livre jamais publié «articipation in Community» retraçait cette démarche d’aller-retour. Elle s’apparente à celle de l’anthropologue et cinéaste Jean Rouch quand il étudiait les populations africaines, tournait des films, puis revenait les montrer aux habitants. J’ai voulu, vingt ans après, retourner dans l’un des villages étudiés pour reprendre la démarche et voir comment la situation avait évolué. L’idée était superbe. On s’est effectivement retrouvé, on a regardé les photos faites vingt ans auparavant, et on a apporté notre contribution à leur projet d’irrigation permettant de récolter les eaux de ruissellement pour les diriger vers les puits existants, et les choses malheureusement en sont restées là. Trop de temps était passé, sans le relais de l'école d'architecture d'Ahmedabad, la dynamique était rompue.
En 1969, nous avons répété la même démarche en milieu urbain, dans trois quartiers d’Ahmedabad : l’un traditionnel et dense, l’autre fait d’habitats précaires, et un lotissement coopératif. On a filmé en 16mm la vie des gens le temps d’une journée, dans ces trois lieux différents : le réveil, les gestes quotidiens, se laver, préparer un repas, le travail, etc. De retour en Europe, à la demande de l’architecte Aldo Van Eyck, j’ai montré le film à un large public en Hollande. Il y fut alors merveilleusement accueilli.
Aujourd’hui il faudrait le transférer sur un autre support...
Ce qui a été signifiant dans ces démarches pédagogiques sur le développement rural et urbain, c’est qu’elles sortaient des méthodes universitaires traditionnelles. Dans sa tentative de se confronter aux problèmes là où ils se posent, l’enseignement a servi de terrain d’essai pour un travail interdisciplinaire en équipe. Les rencontres, les séminaires, les travaux effectués sur place, les discussions à l’intérieur même du groupe ont permis non seulement de comprendre les aspects d’une collectivité et d’en extraire les problèmes clés (“keys issues”) mais de constituer aussi un groupe de pression professionnel qui pourrait épauler des habitants dans leur efforts en faveur d’un développement et d’un urbanisme intégrant leurs attentes, souvent à peine formulées.
Ces problèmes clés, les uns s’ajoutant aux autres, par sujet, forment la chaîne. Les liens entre-eux composent la trame. C’est une idée fondamentale dans mon enseignement, dans ma démarche, et qui peut s’appliquer d’ailleurs à une multitude de territoire.
La démarche elle même, l'université hors les murs découle de Patrick Geddes "l'université militante".
Enseignant en France (1970 - 1975 )
Pour des raisons familiales ("on reste en Inde pour toujours, ou on retourne vers ce que l'on a connu"), nous sommes revenus en France en 1969 où par chance on recherchait des architectes ayant eu une expérience ailleurs... J’ai été conseiller auprès de jeunes responsables qui à l’exception de Florence Contenant, les autres étaient des jeunes énarques au début de leurs carrières du Ministère de la Culture pour préparer la réforme du système des études d’architecture.
1. L’Antenne pédagogique de Cergy-Pontoise
En 1970, avec l’architecte Clément Noël Douady, nous avons créé l’Antenne Pédagogique de Cergy-Pontoise. Le nom d’Antenne venait de André Malraux, alors Ministre de la Culture qui avait souhaité, pour des raisons politiques, éclater et décentraliser l’ancienne École des Beaux-Arts (et ses étudiants causeurs de troubles) en sept, huit, neuf unités d’architecture hors de Paris. J’ai même été convoqué par l’Inspecteur d’Académie à propos du qualificatif “pédagogique” qui appartenait, m’a-t-il dit, à l’Éducation Nationale... Jusqu’où peut conduire le cloisonnement des disciplines en France !
J’ai amplifié l’objectif de Malraux et utilisé cette implantation pour y accueillir les étudiants de toutes les écoles d’architecture et aussi tenter de regrouper ceux d’autres disciplines universitaires (urbanisme, sociologie, géographie), et donner la possibilité aux étudiants de faire des stages de chantier en entreprise, de poursuivre des recherches au sein d'un tissu urbain en formation. Notre but était de mettre en situation, en terrain neutre mais dans un local identifié, différents interlocuteurs, usagers, étudiants (mais pas uniquement des Beaux-Arts), élus, techniciens de l’ EPA (Établissement Public d’Aménagement), de la DDE (Direction départementale de l'Equipement), afin qu’ils travaillent ensemble sur des préoccupations communes.
Le mobilier scolaire a été un sujet, apparemment mineur mais particulièrement porteur, qui a réuni pendant plusieurs mois ces intervenants jusqu’à l’élaboration d’un mobilier flexible et polyvalent, et ceci bien avant les concours sur les mobiliers scolaires. Nous avons pu constater jusqu’à quel point les enseignants du primaire et de la maternelle avaient et ont toujours peu l’habitude de travailler ensemble et de manière créative en présence d’inspecteurs et d’élus. Nous avions eu l’intention de travailler sur la programmation d’un groupe scolaire. Mais, comme toute expérience innovante, elle gênait, elle semblait “remettre en cause les institutions”…. D’autre part, je me suis trouvé moi-même en porte à faux, parce que j’avais comme laboratoire, comme terrain d’étude, la ville nouvelle, alors que j’étais profondément en désaccord avec sa conception et son développement. Au bout de trois ans, j’ai rejoint l’Unité Pédagogique d’Architecture N°8 (UP8), la meilleure école dans Paris.
L’Atelier public d’architecture et d’urbanisme de Coupvray puis de Quincy-Voisin
C’est comme enseignant à UP8, que j’ai contacté le maire de Coupvray qui avait proposé une réflexion sur sa commune, en lui proposant de pouvoir travailler avec les habitants et la mairie en continu avec mes étudiants sur des problèmes qui se posaient sur la commune. Je me souviens qu’à l’époque l’UP8 était constituée de groupuscules, de petites chapelles autour d'autres enseignants, et n’ayant jamais été dans le sérail, j’ai préféré m’engager dans une autre voie, remettant en pratique cette dualité école/terrain que j’avais expérimentée en Inde.
A Coupvray, nous avions un local, accessible de la rue, mitoyen avec la mairie. Les habitants pouvaient y entrer comme ils le voulaient. Mon souhait était d’attirer aussi des étudiants et des enseignants de différents niveaux et disciplines. La planification communale et intercommunale est un moment privilégié du développement urbain et que les étudiants doivent pouvoir, pendant leur formation, suivre au moins une partie du déroulement d’un tel processus. Le problème du logement, de l’habitat doit pouvoir s’insérer dans cette démarche car automatiquement s’y joignent les problèmes d’emploi, de politique sociale, de communication.
On a ainsi réalisé des projets “d’aide à la définition de besoins”, comme projets d’école bien évidemment, mais qui avaient valeur d'illustrer différentes options de mise en forme et servir d'exemples d'aide à la décision.
J’étais opposé à la Ville Nouvelle de Marne-la-Vallée, tout comme j’avais été à Cergy-Pontoise, et tout comme j’aurais été contre l’implantation de Disneyland, qui par la suite engloba tout Coupvray et ses superbes terres agricoles.
Un désastre!
L’année suivante, on a continué, dans la commune voisine de Quincy-Voisin.
Alors que mes projets d’architecte m’accaparaient davantage, et sans connaître ce que signifiait la hiérarchie des postes d’enseignant, j’ai successivement abandonné mon poste de professeur pour celui d’assistant, puis pour celui de chargé de travaux pratiques, et enfin j’ai tout lâché. Je dois être un rare spécimen, si je ne suis pas le seul, qui a ainsi "sacrifié" un devenir d'enseignant.
Effectivement, j’ai une manière d’envisager l’enseignement différente de celle qui se pratique généralement en France. Cela est du en partie à l’expérience dont j’ai bénéficié au départ dans les pays anglo-saxons où les écoles d’architecture sont en réalité des départements au sein d’Universités d’Environnement qui regroupent l’Urbanisme, l’Urban Design", le Paysage, l’Aménagement des grands espaces verts, les Sciences économiques et sociales et les disciplines artistiques.
C'est ce que j'avais appliqué et développé en Inde et tenté d’initier en France.
La Manufacture des Paysages
"Penser les Territoires de Demain"
Villeneuvette et le Coeur d'Hérault
L'urbanisme à la dérive - L’étalement urbain
J'ai toujours été scandalisé par l’évolution de l’urbanisation qui entoure Villeneuvette, et du contraste qu’il y a entre ce lieu singulier d’une indéniable qualité et ces nouvelles formes urbaines dévoreuses d’espaces qui semblent être les seules alternatives à la croissance démographique des communes du Cœur d’Hérault et à la pression foncière qui s’exerce sur le monde rural. Ce sont des réponses toutes faites, comme on en trouve partout ailleurs, à la place d’une réelle réflexion qui s’intégrerait dans des projets urbains à plus long terme. Et puis le double discours des politiques locaux et des administrations de l’Etat qui consiste à vanter la qualité de vie de cette région tout en contribuant à la détruire, m’était et m’est toujours insupportable.
Nous avons créé depuis 2002 pendant les journées du Patrimoine, des rencontres - débats, ateliers - expos autour de ces thèmes. Nous avons également créé une association “ La manufacture des paysages” comme boîte à idées, outil pédagogique, force de propositions pour “penser le patrimoine et les territoires de demain” et faire le lien entre Villeneuvette et le Cœur d’Hérault.
Nous dénonçons les stratégies actuelles de développement urbain qui ont uniquement recours à des lotissements coupés du centre-ville, sans espaces publics ni espaces de rencontres, ou à de très vastes “zones” commerciales uni fonctionnelles, reposant sur l’usage exclusif de la voiture et engendrant l’isolement des habitants et la perte de relations sociales. On baigne dans un no man’s land complet et on construit, à l’horizontale, l’équivalent des grands ensembles, mais cette fois-ci pour les classes moyennes, encore qu’il existe aussi du “bas de gamme” pour des familles plus modestes. Et bien sûr s’y ajoutent les infrastructures routières à haut débit qui ne font que renforcer le mitage de l’environnement et l’étalement urbain.
Nous proposons d’apporter d’autres formes d’urbanisation et d’architecture, qui ne seraient pas en rupture avec l’ancien tissu urbain des villages, et leur mode d’habiter. En occupant moins d’espace, elles renforceraient le “sens urbain” des communes existantes au lieu de les dessaisir de leur identité, tout en permettant une meilleure prise en compte des terres agricoles et le respect de l’environnement. En recherchant une forme et un vocabulaire architectural d’aujourd’hui, elles participeraient ainsi à la réalisation d’une identité dynamique et contemporaine. Le territoire est un bien commun à entretenir, à partager et à protéger selon un principe d’équité.
En réalité les communes, ici dans le cœur d’Hérault, sont les seules à avoir un droit sur l’urbanisme, ce qu’on appelle la compétence. Les trois communautés de communes du Pays Coeur d'Hérault, n’ont pas opté pour cette compétence, si bien que chaque commune garde la maîtrise de son territoire. Il y a des aménagements intercommunaux concernant les ordures ménagères, le ramassage scolaire par exemple, ou le développement économique (ce qui se traduit notamment par l’implantation massive de ces zones commerciales et artisanales sans qualité). Mais concernant l’urbanisme, il y a un vide total. Et le projet d’accroissement d’une commune se fait sans concertation avec les communes limitrophes. C’est une aberration. C’est une histoire politique de petits fiefs, de petits chefs qui veulent garder leur pouvoir. Les maires sont les seuls maîtres à bord.
Comment leur faire prendre conscience des problèmes liés au développement urbain, à la nécessité d’une gestion démocratique du territoire qui passe par la concertation, la mixité sociale et la volonté de vivre ensemble ?
Il faut commencer par faire de la pédagogie pour élu local, mais aussi à tous les niveaux, enfants, adultes, citoyens. Il faudrait une “insurrection des consciences”, comme dit Pierre Rabhi. Il faudrait aller voir ce qui se passe ailleurs, dans des villes européennes démographiquement équivalentes. Continuer à provoquer des rencontres, des débats, généraliser la pratique du jeu urbain et des études comparatives entre anciens et nouveaux tissus urbains, rédiger des livres blancs ou noirs sur l’état des lieux, élaborer des chartes sur le devenir urbain, créer un outil permanent, un atelier d’urbanisme d’analyse, d’étude, de planification et de sensibilisation des habitants, doté d’une équipe professionnelle et pluridisciplinaire, etc.
Ici le discours habituel, aussi bien des élus que des professionnels de l’urbanisme ou d’ailleurs, c’est de répondre à ce que “demandent les gens”. Et que veulent les gens ? Vendre leurs terrains et leurs maisons de village. Avoir de l’eau, mais pas d’inondation. Un peu de paix, quelques fêtes pendant l’année, pas trop de voleurs. Mais c’est un discours à double tranchant, parce qu’on ne leur donne pas vraiment le choix, aux gens. Et d’autre part, la seule chose à faire pour un maire, s’il veut être réélu, c’est vendre la terre agricole en terrain constructible.
Il faudrait trouver des exemples de syndicats intercommunaux avec d’autres ambitions. Comment le savoir ? En faisant venir des étudiants sur le terrain.
Pourquoi venir faire de l’agit-prop en Languedoc ? Alimenter et poursuivre le combat contre la mondialisation, dans la proximité du Larzac sur le thème “un autre monde est possible” ? Occuper les terres viticoles avant qu’elles ne deviennent des lotissements, comme le suggère la Confédération paysanne ? Initier des actes symboliques forts et fédérateurs, des actes de défiance pour faire avancer les choses ? Essayer pour le moins de faire prendre conscience aux gens de la catastrophe qui se prépare et qui touche aux façons de vivre et d’habiter le pays face à une extension urbaine mal gérée, dans le laisser-aller politique ambiant, la pensée à court terme et l’absence de projet ?
Des événements, des temps forts comme ceux autour des Journées du Patrimoine. Des blocages aussi. Des hostilités. Du non-dit. Du double discours. Et peut-être demain enfin, un projet qui pourrait se concrétiser et “secouer le cocotier”. Une autre manière, ici, au cœur de l’Hérault, de fédérer et de poursuivre la route.
“Musée vivant de la ville”,
maison de pays,
centre de ressources
L’idée de la maison de ville est un concept qui accompagne ma démarche depuis très longtemps, un outil collectif qui représente le contraire d’un projet individuel et qui peut se réaliser à une toute petite échelle, d’où l’idée qu'ai minimum on pourrait utiliser un placard qui a pu faire sourire. Il s’agit de créer dans chaque commune, ville, communauté de communes, une dynamique sur l’ensemble des questions urbaines, de permettre de se doter d’un lieu de ressources où l’ensemble des documents relatifs à l’urbanisme seraient consultables aisément par les élus, les professionnels et surtout le grand public.
L’idée même de la maison de ville est une extension de “l’Outlook-Tower” de Patrick Geddes, concept et réalité. Dès 1892 en effet, Patrick Geddes, avait aménagé une ancienne tour située au cœur et au sommet d’Edimbourg en véritable laboratoire de recherche et d’observation de la ville, ouvert au public. Depuis la hauteur de sa plate-forme, les visiteurs pouvaient acquérir l’expérience de la “vision d’en haut” du quartier environnant. L’étage en dessous était consacré à la ville d’Edimbourg, et au fur et à mesure que l’on descendait, la documentation s’élargissait à la région, au pays, à l’Europe. A chaque étage, les informations étaient présentées sous une forme vivante de plans-reliefs, de maquettes, de tableaux et graphiques, de “cartes du social et de l’industrie”, similaire en beaucoup de points aux écomusées de Marcel Rivière.
Il suffirait aujourd’hui, d’adapter cette idée aux besoins de la ville contemporaine, en perpétuelle évolution. Chaque ville devrait disposer d’un véritable fond de connaissance de ses origines et des différentes étapes de son développement, car c’est l’histoire de la ville qui permet d’appréhender sa réalité quotidienne et d’imaginer son devenir. L’intérêt croissant que portent les habitants à leur environnement, sans pour autant avoir la possibilité d’intervenir, est à prendre en compte également. La complexité des mécanismes liés à la ville, la forte interaction entre le global et le local, entre la mémoire et le projet, entre la conception et la décision nous imposent un véritable espace d’intelligence. La maison de ville répond à cette demande : lieu d’information et de services, de formation de tous les citoyens, de rencontres et de débat aussi, lieu de transversalités et de passerelles de savoir, c’est un outil démocratique à usages multiples.
Il faut avoir vécu la présentation d’un projet d’architecture ou d’urbanisme dans la salle d’un conseil municipal pour se rendre compte combien l’ambiance et l’organisation se prêtent difficilement à une réflexion réelle, à un vrai travail de compréhension des projets. Les décisions sont prises malgré tout, sans affichage de plans d’occupation des sols et cadastres, de plans des communes limitrophes, de photos aériennes et maquettes de villes, d’études anciennes et récentes, de simulations, de données sociales, économiques et urbaines... Et pourtant ces documents existent, ils sont simplement disséminés à travers le territoire municipal, départemental ou régional, dans différents organismes, bureaux et services, chacun ayant sa spécificité, son domaine d’intervention. Démunis d’outils d’analyse, les élus et autres participants n’ont pas accès à l’ensemble des éléments qui pourraient leur permettre d’effectuer une évaluation comparée, et de prendre des décisions véritablement informées. Sans pour autant décharger ces intervenants de leurs responsabilités, il suffirait de mettre en relation tous ces partenaires par le biais d’un réseau et d’un lieu fédérateur dédié à la problématique de la ville.
La création d’un tel lieu aurait des retombées positives sur l’insertion des écoles au sein de la cité, tant il est vrai que l’élargissement de l’enseignement de l’architecture et de l’urbanisme à la demande sociale et aux autres disciplines est une nécessité fondamentale de survie pour le système éducatif français. L’université, prise au sens le plus large, réunit toutes les disciplines. Les problèmes posés par la ville touchent toutes les disciplines. Et pourtant, en France, l’université et la ville fonctionnent de manière cloisonnée, dépendent de ministères distincts. Cette situation est d’autant plus aberrante que sur le terrain, tout est étroitement imbriqué. On ne peut espérer résoudre les grands problèmes de nos villes en se référant à des disciplines aux parois étanches. La confrontation du monde de l’éducation aux réalités et demandes sociales ne peut être que salutaire et bénéfique à tous.
Le projet de “Musée vivant de la ville”, appelé aussi “Maison de ville” ou “Centre de ressources” a fait l’objet d’une mission de recherche que nous avons menée en 2000-2001, commanditée par la Direction de l’Architecture et du patrimoine au Ministère de la Culture. Il a vocation à s’inscrire naturellement dans le cadre des conventions de ville et pourrait s’appliquer à toutes les échelles d’une entité territoriale : village, ville, agglomération, district. Aujourd’hui, les nouvelles technologies de communication permettent également d’associer à l’espace physique d’un tel lieu contenant des activités d’information, d’exposition et de formation, un équipement multimédia et un espace virtuel (site “portail” internet recensant intervenants et activités à l’intérieur d’un territoire, banques de données, utilisation de SIG, systèmes d’information géographiques, etc.).
L’urbanisme et l’architecture d’une ville devraient être le miroir de son projet de société, reflétant son vécu de la vie quotidienne et ses aspirations à long terme. Cette démarche de recherche-action autour du développement urbain et des maisons de ville, dont la pertinence est décrite dans la loi SRU ( Solidarité et Renouvellement Urbain ) implique le recours à de nouvelles méthodologies de conception, à la création d’équipes pluridisciplinaires pour élaborer des façons de faire qui vont à l’encontre des pratiques actuelles. Rien ne pourra voir le jour sans une réelle volonté politique et sociale de la part des élus et de toute la population.
Pour un projet urbain intercommunal
Le problème des territoires ruraux qui regroupent une vingtaine, voire une trentaine de communes est un sujet aussi préoccupant que celui des projets urbains “de villes” et des agglomérations.
C’est le cas, ici, dans le Cœur d’Hérault :
- Les communautés de communes n’ont pas de compétence sur l’urbanisme.
- Les communes, seules responsables de leur urbanisme, permettre la construction à tour de bras de lotissements, de zones commerciales, d' entrées de ville catastrophiques... La plupart naviguent à vue et sont la proie des aménageurs, et certaines d’entre elles doublent de superficie tous les dix ans. Les petites maisons au faux style régional pullulent, chacun chez soi, etc.
- Le département entretient (comme tous les élus d’ailleurs) un double discours et laisse faire.
- Même chose avec la DDE et les services de l’Etat. La direction de l’Equipement aggrave la situation avec la construction d’autoroutes qui drainent encore plus de population des grandes villes et contribuent ainsi à l’augmentation de la pression foncière.
Face à cet individualisme forcené, face à l’inertie des pouvoirs, comment introduire une composante collective, un regard commun partagé ?
La Manufacture des paysages souhaiterait, avec d’autres partenaires de la “société civile” créer un réseau, voire une structure informelle qui deviendrait une force de proposition pour des projets de développement alternatif dans ce territoire, disons un projet urbain intercommunal.
La masse grise et informe grandit et grignote ce superbe territoire qui est en train de se dégrader à grande vitesse sans que personne n’y prenne garde.
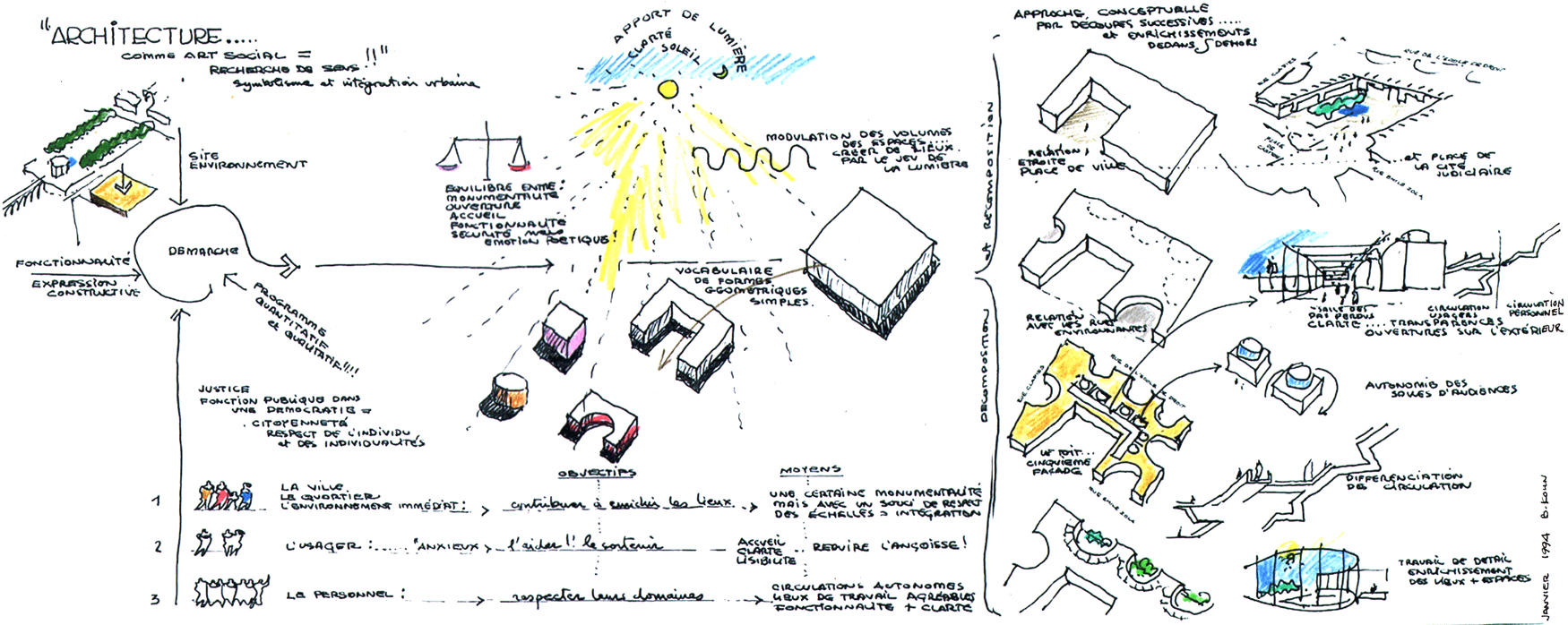
3. Démarche architecturale et urbaine
Annexes :
- Texte de J.P.Vaysse sur la démarche de BK
- Article de mai 1981 : “Technique et Architecture : de l’espace domestique à la ville, une succession d’appropriations”, entretien avec BK
Démarche architecturale et urbaine : de la conception à la réalisation, essai de communication
Comment rendre tangible, intelligible le cheminement souvent obscur, mystérieux et très subjectif qui conduit de la conception à la réalisation ? Faces vues, faces cachées, territoires peu balisés... C’est comme une terre étrangère, une traversée au cours de laquelle on édifie chaque jour quelques repères à peine visibles.
Ce souhait de lever certains voiles, d’établir des vases communicants est certainement utopique. Il répond au désir de créer des cohérences entre vie personnelle et vie professionnelle, entre pensée et action, entre le processus de réalisation et son aboutissement.
Cette tentative d’explication de soi et de ceux avec qui nous sommes amenés à travailler, la mise en lumière de nos spécificités, est pour moi une donnée qui peut influencer, modifier l’architecture que nous produisons. C’est un élément générateur qui inspire et donne une substance humaine à nos constructions, sans laquelle elles ne seraient qu’une enveloppe lisse où ne pourraient s’incruster le vécu, l’usage, la vie quotidienne.
L’architecture est pluridisciplinaire et pluridimensionnelle, d’étapes en étapes, d’intervenants en intervenants, on passe la main, comme on le ferait d’un témoin dans une course de relais.
La réflexion initiale sur le projet, la programmation, la conceptualisation, la matérialisation, la réalisation sont autant de phases de nature complémentaire, bien que différentes dans leur essence. Entre chacune, il y a une “perte de charge”, un glissement que nous ne pouvons contrecarrer qu’en affinant la définition de fils conducteurs, d’idées clés. Ce sont elles qui permettent de tisser ensemble les éléments successifs qui ponctuent l’évolution du projet.
Ces difficultés existent entre les intervenants, comme à l’intérieur de chacun d’entre nous ; elles expliquent en partie le décalage entre projet et réalisation, entre notre imagination et notre pouvoir de concrétisation. Ce dilemme est au cœur de toute création.
Il y a des démarches, des attitudes liées à la création qui peuvent être du domaine de l’intime et que l’on ne souhaite ni expliquer, ni communiquer.
On peut se sentir plus ou moins concerné par les enjeux, les réflexions et débats du monde qui nous entoure : les inégalités sociales, la destruction de l’environnement, la globalisation…
On peut s’en extraire, ou au contraire y trouver une raison d’être.
Pour moi, le choix est évident et immédiat : je n’accepte pas “n’importe quelle commande”, je préfèrerais les projets qui touchent directement aux aspects culturels, pédagogiques de notre société, plutôt qu’à ceux qui sont liés à des enjeux commerciaux.
C’est ainsi que j’ai été amené aussi bien dans le domaine professionnel que pédagogique, à élaborer et utiliser des démarches qui permettent à un plus grand nombre d’acteurs de mieux comprendre et de s'ouvrir aux enjeux d'un problème posé, comme la dévalorisation d’un quartier, la spoliation des terres agricoles, la destruction des équilibres écologiques, l’accroissement irraisonné des villages.
Parfois on est amené à ne pas jouer le jeu de la prétendue solidarité académique ou professionnelle envers ceux par leur absence ou présence contribuent à cette dégradation irréfléchie de l'environnement...: toujours plus de lotissements, de zones commerciales et artisanales...
Démarche
J'éprouve une nécessité, que peux de mes confrères partagent, de vouloir expliciter ma manière de penser, ma démarche de conception, de tenter d’en relever les origines, puis consciemment de les afficher, les utiliser moi-même, les communiquer aux autres afin de solliciter leur adhésion, compréhension et participation.
Réfléchir ensemble passe par les débuts d'un langage commun qui combine l'oral, l'écrit, le visuel, sous forme de schéma et d'annotations graphiques, permettant un dialogue constructif, d’échanger des objectifs, concepts.
Puis par la suite, au cours de l’évolution du projet, d’en vérifier la pertinence en se référant aux principes initiaux
Quels sont quelques-uns de ces principes qui sous-tendent la réflexion lors de l’élaboration d’un projet ?
Il s’agit de garder toujours présente une vision globale, la recherche de sens, de fils conducteurs, de lisibilité et de transparence de la démarche conceptuelle.
Ce qui implique :
- De clarifier et d’afficher le processus de conception qui est adopté, de faire connaître l’organisation et la hiérarchie décisionnelle des intervenants, d’adhérer et essayer de se plier à un planning de phases, d’étapes, de « rendus »…
- Dans un climat qui permet le dialogue, mais aussi qui laisse la place à la confrontation et aux contradictions, d’utiliser des méthodes d’analyse qui convergent vers l’établissement de bases communes d’où peut naître un énoncé cohérent de projet.
Vision globale
C’est avant tout un état d’esprit, une mise en situation personnelle et collective, c’est faire cohabiter de multiples visions, faire en sorte que puissent se superposer différentes échelles : régionale, urbaine, de quartier…
Cela ne s’apparente en rien à une pensée unique, c’est bien au contraire l’acceptation d’une multiplicité d’éléments contradictoires mis en dialectique permanente, c’est une méthodologie de travail toujours en mouvement, optimiste dans sa manière de faire surgir des éléments générateurs, des cohérences, mais consciente aussi des risques d’échec ou d’erreurs inhérents à sa mise en œuvre.
C’est une approche non linéaire, complexe où l’on procède par aller-retour du général au particulier et inversement par bonds en avant, pour permettre à n’importe quel moment de faire un bilan (et une proposition d’étape), d’en mesurer les répercussions et les conséquences au niveau d’un détail voire d’une hypothèse décisionnelle.
Au niveau de la conception d’ensemble, c’est pouvoir confronter :
- le social, le politique, l’économique et le spatial,
- l’intérêt collectif et l’intérêt individuel,
- la réflexion et la pratique,
- le travail « productif », et la formation,
- le réalisme, l’abstraction et l’utopie,
- la naïveté et la stratégie.
Projet
Le mot projet, que je préfère de loin au mot “opération” ,qu’utilisent les promoteurs, les “monteurs d’opérations” et même des architectes, contient dans sa définition une multitude de sens : on parle aussi bien de projet social, de société, que de projet personnel, collectif, ou de projet d’aménagement, d’urbanisme, d’architecture.
C’est à partir du programme essentiellement quantitatif, établi par le client - maître d’ouvrage, qu'au début s'exprime le projet.
A partir de ces données écrites, souvent trop rigides, il faut pouvoir s’en détaché, imaginer, planer, s’ouvrir, émettre des hypothèses, élargir le programme en lui insufflant des données qualitatives.
Puis en des allers retours successifs. prendre à nouveau contact avec le programme.
Ce va-et-vient entre l’expression du vécu et du rêve, du rationnel et de imagé peut permettre d'entrevoir l’enracinement, le fondement, le sens du projet.
Dans le projet , qu’il se développe au sein de l’atelier de l’architecte, dans le cadre de réunions avec les clients,et dans les projets urbains avec les habitants, les maquettes d’études, et non des maquettes dites de présentation, sont à la fois des outils d’étude, de partage.
La maquette d’étude, dont on peut manipuler les éléments, voire en retirer ou en adjoindre d'autres, est un outil « démocratique », dans le sens qu'elle permet à chacun de modifier les emplacements des éléments sans crainte de « ne pas pouvoir dessiner », de ne pas « être architecte »...
C'est aussi le cas de dessins élaborés, sur un grand format, devant les participants.
Des premiers traits, au développement du dessin, on intériorise mieux l'ensemble, que face à un dessin déjà réalisé.
La recherche de “formes porteuses de sens”, qui répondent à une vision partagée
La notion de forme n’implique pas que le spatial, elle englobe l’essence d’un projet, elle en est l’archétype ; le concept de "forme", comme le définit Louis i Kahn, est distinct de la "mise en forme", de sa matérialisation.
C’est avant tout le désir de toucher « juste », la recherche des éléments porteurs de sens qui donneront ses racines au projet d’aménagement, d’urbanisme, d’architecture qui viendront accueillir les vécus, les usages.
Cette démarche, inconsciente, souvent instantanée et immédiate ce qui peut être totalement acceptable si l’on travaille seul, peut, si nous travaillons à plusieurs, être explicitée, analysée, “défibrée”, car c’est bien par croisements, superpositions, synthèses d’inspiration que nous opérons :
- synthèse de la connaissance des activités sociales, culturelles, économiques, de la connaissance des enjeux, des non-dits, des contradictions portées par les institutions qui se sont éloignées de ce que sous-entendait leur création.
- synthèse de la connaissance de l’espace physique, urbanistique, architectural, de son passé, son existence actuelle, ses potentialités, et du repérage des lieux significatifs de la vie sociale et collective.
- synthèse de la connaissance du site, allant du grand paysage aux composantes de détails. Lire le paysage, et le sens de ce paysage, le décrire, le renforcer…Lire le sens des pentes, des lignes des arbres, des cultures, pour s’y inscrire, dialoguer, mettre en valeur…
- sans oublier les références formelles explicites, implicites des intervenants qui peuvent surgir à tout moment…
Ces « formes porteuses de sens » peuvent être découvertes par la recherche de fils conducteurs, voire même d’un seul fil transversal ( la trame) qui relie les fils verticaux (la chaine ), donnant ainsi réalité au « tissu », à la fabrique.
Vers une méthodologie de projet la plus « transparente » possible…
Il est indispensable de rechercher à expliciter les non-dits, les a priori, les sous-entendus qui concernent aussi bien les maîtres d’ouvrages que les architectes et les futurs utilisateurs, mais aussi à donner une vision globale des éléments organiques et constructifs de la ville à ses différentes échelles.
Sans suggérer une méthodologie de conception totalement partagée, et à laquelle je ne souscris absolument pas, nous pouvons tout de même tenter de mettre en place une méthode et des outils de dialogue qui favorisent l’expression des souhaits et la prise en compte des besoins du plus grand nombre, .
Ceci implique de faire l’effort de lever le voile sur ce qui habituellement entoure la démarche de conception d’un projet d’urbanisme, d’architecture, et que souvent les concepteurs et les maîtres d’ouvrages laissent à peine transparaître : l’explication non démagogique du processus de prise de décision politique, la démystification de la “boîte noire” de la conception, par exemple...
C’est dans la confrontation des différentes visions, l’importance accordée à tel ou tel aspect de la réalité urbaine (comme la préservation d’un potentiel écologique ou agricole, la nécessité d’un développement industriel, la création d’emplois, la réhabilitation et extension d’un quartier, d’une commune, etc.), tout en conservant la globalité de l’approche, que pourront être pris les choix collectifs
Ces efforts vers plus de transparence concernent toutes les étapes d’un projet : de la réalisation de documents de programmation, d’organigrammes des différentes étapes d’interventions et de décisions, jusqu’aux outils de conception.
Outils d’aide au processus de compréhension, de conception, d’action
Les outils ne sont jamais neutres!
Toute méthode est porteuse d’une problématique et imprégnée d’une idéologie et d’une orientation.
On ne peut contourner cette réalité, et ce n’est pas souhaitable. En faisant avec, on rend plus “communicable” le processus de conception.
Je souhaite favoriser, de part et d’autre, la transparence et l’interaction.
Au sein de notre équipe de conception, parmi les méthodes et moyens que j'utilise entre nous, ainsi que dans nos rapports avec l’extérieur, je peux énumérer à titre d’exemples :
- l’organigramme pour clarifier le rôle et l’organisation des intervenants
- la planification des phases, pour clarifier le cheminement et le processus de conception
- les fiches d’objectifs, comme autant d’outils d’analyse, défibrage, superposition de confrontations
- les langages d’expression et de communication : maquettes, schémas, descriptions synthétiques, photos, etc., permettant d’accroître la compréhension et l’adhésion des intervenants, en favorisant l’utilisation au sein d’un même questionnement de plusieurs langages.
Dans des projets urbains où interviennent une multitude d’intervenants, peut-on espérer suivre une démarche qui permettrait de rassembler en un seul document tous les objectifs et paramètres qui gravitent autour de chacun ?
Peut-on entrevoir des démarches, des outils susceptibles d’accompagner, nourrir, et orienter un projet, dans son déroulement d’étape en étape, depuis la programmation initiale, de la conception jusqu’à la fabrication, processus qui peut durer de trois-quatre à dix voire quinze ans…, avec le risque de profondes modifications d’équipes de maîtrise d’ouvrages, d’élus qui peuvent ainsi remettre en cause certains acquis ?
Est-ce une illusion ?
Je me suis beaucoup concentré sur les documents qui sont associés à la phase de programmation, la réalisation de « chartes » qui intègrent tous les éléments relatifs au questionnement, la réflexion et la prise de positon que doivent effectuer la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre, etc.
Souhaiter la participation des intervenants du cadre bâti est une chose. S’en donner réellement les moyens, une toute autre chose, les mettre en pratique et trouver dans l’action les effets de la réflexion et des intentions de départ, un but difficile à atteindre
Comme un voilier sur une mer tranquille, avec une ligne d’horizon ininterrompue, on pourrait imaginer modifier son cap sans s’en rendre compte.
On peut imaginer l'élargir en se gardant de ne pas se retrouver naviguant dans le sens contraire.
Dans « nos » projets, des logements du Buisson Saint-Louis au métro Météor, puis à celui de Turin, l’élaboration de documents intégrant aussi bien l’énoncé des objectifs de départ que ceux qui se développent par la suite, avec des hypothèses et des propositions de matérialisation, ont permis de mesurer l’écart entre la conception initiale et la réalisation finale - avec des variations allant de 90% à 50%, en fonction de l’adhésion des uns et du rejet partiel des autres.
Ces 50% auraient-ils encore baissé si l’on n’avait pas eu recours à un minimum de consensus ?
Ces références à des formes collectives impliquent l’élaboration de « fiches modèles » : « patterns » en anglais, suivant la définition et les travaux de Christopher Alexander, notamment dans « The Pattern Language » (pas traduit à ce jour), qui permettent de s’appuyer sur un certain acquis, comme autant de points d’ancrage et de repères méthodologiques.
Ces fiches d’objectifs, s’articulent à l’intérieur de cahiers ou de chartes, documents de référence pour la conception et la matérialisation d’un projet au cours de son long cheminement.
« Cahiers de bord », « Chartes architecturales et urbanistiques », « Documents des enjeux », autant de documents qui peuvent en partie réduire la part de subjectivité, de décisions intempestives, de choix unilatéraux de l’un des intervenants, qu’il soit représenté par l’équipe des « décideurs » ou celle des architectes.

4. Des projets de territoires aux projets d'architecture
Texte de présentation, architecture publique et espace urbain
- Se sentir bien dans un lieu
- Les rives de la Sabarmati (Inde)
- Météor (ligne 14 de la RATP, Paris)
- Les Palais de Justice, Montpellier et de Clermont Ferrand
- Annexe : Article de Mai 1980 (L’Équipement 63) n° 18
L'architecture...
C'est pouvoir créer et façonner des lieux qui témoignent de et qui participent à la beauté du monde, des lieux où l'on se sent bien, et qui permettent à ceux qui y habitent d'exprimer et de contribuer à ce bien être.
Ce sont des lieux qui rayonnent d'une présence, et qui nous incitent à révéler vers le mieux de nous mêmes, ceci à toutes les échelles, dès grands paysages au projets de territoires, de villes, de réseaux d'espaces publics, d'ilots, de bâtiments jusqu'au plus petit détail du quotidien. "Small is Beautiful" (E.F.Schumacher), et Dieu est dans le détail" (L.Mies van der Rohe).°
On ne peut pas de se dédouaner de ne pas être un professionnel et de vouloir se remettre à d'autres, car nous ressentons tous la différence entre un bon, un moins bon, et carrément un mauvais lieu.
Se sentir bien dans un lieu:
"C’est un peu comme se sentir bien dans sa peau, ce pourrait être le souhait de tous les habitants, et de tout architecte qui se respecte et respecte ceux qui sont les destinataires de ses projets. Se sentir bien dans un lieu, cela peut à l'inverse être de partir de chez soi, du plus intime et déborder, passer du dedans au dehors, franchit le seuil, cheùiner par les ruelles, rejoindre la place publique et les espaces naturels.
C'est une façon d’apprendre à regarder, à écouter, à marcher, à parler, à circuler, à inscrire son corps dans l’espace, à rencontrer l’autre.
Il y a des tas de gens qui ne "savent" pas où se mettre, comment habiter leur corps, leur intérieur, la ville, et comment approcher l’autre.
Etre hanté par cette question du bien-être à créer, à donner, à partager, c'est une question de méthode et d’éthique. Il y a une logique humaine à tout cela, une cohérence, la vie et l’œuvre tissées inextricablement, avec toujours le retour à l’étincelle du départ, comme dans la rencontre.
Se sentir bien dans un lieu, c’est une autre manière de se demander à quoi sert un architecte, un urbaniste.
Il y a des lieux qui semblent avoir inscrit depuis toujours leur place dans l’espace et l’histoire des hommes, dont l’harmonie et la beauté continuent à vivre et à enchanter ceux qui les habitent, ou les approchent. On parle du génie des lieux.
Il y a la ville qui se fait et se défait, qui se reconstruit en permanence sur elle-même, il y a la terre, les fleuves, l’air et les arbres, aimés ou malmenés, qui continuent à appeler à l’aide et au respect. Il y a tout l’espace à envisager. Apprendre à habiter le monde, à le rendre habitable.
Par où commencer ?
Les aspérités
Dans les maisons de nos village ou les vieux appartements parisiens, il y a des astuces dans les dispositions des pièces, des interstices, des coins et recoins qui se “laissent habiter”: des fenêtres "épaisses", des rebords, des cheminées sur lesquelles l'on pouvait poser des plantes, un objet personnel, un vase...
À une plus grande échelle, viennent les paliers, les entrées des maisons et immeubles, les courettes et jardinets, les seuils avec quelques marches où l’on peut s’asseoir. Les chats ont l’art de se placer au bon endroit dans ces lieux, ces espaces intermédiaires, ces “entre-deux” si bien décrits par Aldo van Eyck.
Certaines des constructions d'après guerre avaient simplifié tout cela, remplaçant les «aspérités» , comme les cheminées par des toitures lisses, des façades et fenêtres sans rebords..
À l' intérieur, des surfaces planes qui ne peuvent en aucun cas accueillir les objets qui accompagnent notre quotidien.
Les espaces publics
De la maison à la ville, au territoire, nous avons substitué à la complexité de ces lieux habités, une sorte d'homogénéité d’ambiances et d’activités, une standardisation de l'espace urbain qui fait qu’un lieu n’est que la répétition d’un autre, d’un centre commercial à un autre, qui ne sont qu’une juxtaposition de boites innommables, que seules les énormes enseignes distinguent. D’une zone à une autre, d’une « entrée de ville » à une autre, d’une périphérie de ville à une autre, d’une zone pavillonnaire à une autre, nous construisons des espaces mais pas des lieux.
Souvent absente de tels projets, face à cette situation, que peut « l’architecture »?
Elle peut donner du sens.
Mais, l’architecture seule ne peut résoudre les problèmes qui sont à la base politiques, sociaux, et par rapport auxquels la société n’a pas pu, ni su faire face.
Ce n’est pas en badigeonnant de couleurs vives les grands ensembles, complètement coupés des centres villes et où sont reléguées des populations sans emplois que l’on rejette socialement et économiquement, que l’on peut espérer trouver une réponse.
Il n'y a pas de réponse architecturale possible face aux 45% de chômages des jeunes qui y habitent.
Elle est bien évidemment tout d'abord politique, culturelle, sociale.
Progressivement, on peut intervenir en resserrant l'éparpillement de ces tissus urbains, en les reliant les uns aux autres par des cheminements et non uniquement des voiries, en complexifiant les zones uniformes en une multiplicité d’usages que l’on peut contribuer à créer un urbanisme plus à visage humain.
La qualité de l'espace urbain est la résultante d’une réelle volonté démocratique.
Les espaces publics lieux qui "fonctionnent" mieux , sont souvent des lieux “suffisamment bons” du psychanalyste Daniel Winnicott, lieux sensibles, lieux qui accueillent, où il est possible de cheminer, rêvasser, lieux qui intègrent la personne comme elle est, qui ont une présence, une identité, une charge affective, une histoire
Lieux complexes, énigmatiques, qui possèdent une certaine qualité d’ambivalence, une certaine porosité, qui résistent à toute codification, et qui permettent un dialogue silencieux avec l’utilisateur, le passant qui en devient le participant, le passeur.
Comme illustrations de tels lieux où l’on se sent bien, on peut se tourner vers ces places de villes italiennes, souvent irrégulières, sans véritables centralités, mais avec de multiples ramifications.
La grande place d’Arezzo, d'une forme "plutôt" rectangulaire, à partir de la grande façade sous arcades légèrement en pente jusqu’aux constructions plus variées vers le bas.
Des escaliers courent le long des faces latérales qui suivent la pente. Au centre, deux éléments de mobilier urbain, une fontaine et un petite construction. Cette place représente une multiplicité de potentialités d’accueil, de situations, d’usages, selon qui on est, son humeur ou le temps qu’il fait, en retrait sur les marches de l’un des grands escaliers, ou au milieu, bien en vu, ou encore protégé sous les arcades où se trouvent les restaurants.
Les espaces sont comme les gens, il y en a qui vous interpellent, qui ont une présence lumineuse, d’autres qui vous indiffèrent, d’autres qui vous agressent, d’autres enfin qui sont faussement attractifs, qui sont dans l’illusion et la représentation.
Peut-on concevoir ex-nihilo de tels lieux, lieux d’où personne ne peut être exclu et où l’on se sente bien? On rêve tous de pouvoir les créer.
Parmi d'autres, et à titre d'illustration, voici des projets ou ce souci, cette préoccupation de construire des lieux accessible à tous et où l'on se sente bien, ont été au cœur de leurs conceptions.
Les rives de la Sabarmati, Ahmedabad, Inde
C'est un projet auquel je tiens par dessus tout, l'ayant proposé en 1963, alors que je vivais et travaillais en Inde, qui est toujours en cours, après 40 ans, comme un éternel présent, ou une plaie ouverte, c’est l’aménagement de la Sabarmati, à Ahmedabad. J’ai fait alors de grandes maquettes et de nombreux dessins pour un développement intégré des rives du fleuve, puis je suis parti et je n’y suis retourné que trop longtemps après. Ce n’est pas un hasard si je me suis intéressé en France aux rivières ; il y a effectivement une thématique de l’eau et de la ville qui me poursuit.
Souvent, dans l'histoire des villes, les fleuves ont été des lieux de rejet.
L’idée de « retourner» la ville sur l’eau est une thématique relativement nouvelle en urbanisme.
Par contre, de rendre ces rivières accessible pour le plus grand nombre, et pas à l'avantage de certain, aujourd'hui même demande une mobilisation constante.
Malheureusement, Ahmedabad, et sa rivière Sabarmati en est une illustration.
D'une idée, je dirais généreuse sociale et de partage, elle fut reprise par un architecte moins soucieux de ces objectifs, et plus porté par des objectifs et visées de développements commerciaux.
J’avais proposé alors à l'aménagement des deux berges de ce vaste fleuve, potentiellement le plus grand espace public de la ville, pour l’usage et l’agrément de toute la population, en évitant la tentation d’en faire des voies rapides pour l’automobile ou d’y construire des bâtiments de standing.
Le fleuve traverse la ville du Nord au Sud. Dans le projet, il est perçu comme un énorme soleil dont le rayonnement, le scintillement s’infiltrent dans la ville.
Ses berges peuvent accueillir tous les habitants des quartiers proches, par des ruelles perpendiculaires, comme autant de « trames » transversales d’un tissu. Les cheminements et les promenades linéaires le long du fleuve en deviendraient la chaîne : trame et chaîne tissant ainsi un vaste tissu urbain.
Palais de Justice de Clermont Ferrand et de Montpellier
J’ai travaillé sur les étapes successives d'appropriation, ces différents paliers d’accès à un lieu un peu prestigieux, qui symbolise la justice, et où l’on a peur d’entrer, parce qu’on y vient généralement pour un problème personnel peu glorieux. Il y a des seuils successifs, puis une colonnade, puis un patio avec un plan d’eau et une fontaine, une qualité de lumière. J’ai inscrit dans l’espace plusieurs manières possibles de l’aborder, de l’utiliser, avec une liberté de circuler, ou de s’isoler pour un rendez-vous avec son avocat, près de la fontaine, sous la colonnade, etc.
Au cours des années, de plus en plus d'impératifs « sécuritaires » ont été imposés par la « maitrise d'ouvrage », à l'encontre de ces aménagements qui agrémententaient l'accueil des usagers et du personnel.
Météor, ligne 14, RATP Paris
L’aménagement des station et quais du métro Météor de ses mezzanines permettent de se repérer dans l’espace, de voir où l’on va, de ne pas déboucher soudainement sur le quai, qui avec des recoins sur toute sa longueur où l’on peut s’asseoir.
Comme ce fut le cas, dans d'autres projet, pour des raisons sécuritaires, ils ont été réduits.
J’ai tenu, dur comme fer, au principe des puits de lumière - naturelle ou artificielle - qui ont pu être réalisés dans plusieurs stations. Ceci, face aux critiques constantes de notre maitre d'ouvrage, moins sensible aux besoins des usagers
En mars 1990, la RATP lance un concours pour la conception architecturale de l’aménagement des stations de la nouvelle ligne de métro, ligne 14, dite Météor. Il s’agit de relier les quartiers Est de Paris aux quartiers d’affaires du Centre de la capitale. La RATP envisageait une nouvelle technologie avec des rames plus rapides, sans conducteur. Cette option devait entraîner nombre de modifications structurelles et sociales, tant au niveau de l’organisation interne de l’entreprise que de la conception architecturale des stations. Il a fallu huit ans pour réaliser six stations sur celles que comprend la ligne actuellement, et permettre à ce grand projet souterrain de voir le jour.
Un projet architectural et urbain mûrit lentement, à partir d’une demande formulée, puis au fil de réflexions, d’échanges, de réponses à de multiples exigences. Il intègre également tout une mémoire de choses vues, fonctionnelles et tangibles ou au contraire, qualitatives et moins saisissables. Du début de l’étude jusqu’au dernier jour du chantier, tous les paramètres s’enchevêtrent dans un foisonnement de lianes composé d’objectifs atteints, mais aussi d’idées esquissées, inachevées, ou même abandonnées.
Le défi qui se présente aux concepteurs est bien celui d’atteindre l’adéquation la plus parfaite entre les intentions initiales et la réalité construite que les usagers expérimenteront au quotidien. Une fois les espaces et les volumes construits et habités, chaque usager peut s’approprier les lieux, y être sensible, apprécier la lumière, les matières, l’espace. Ce n’est qu’à ce moment-là que les projets vivent et se vivent.
Un projet est bien plus qu’un qu'un ensemble d'espaces, surtout lorsqu’il s’agit de fabriquer
des lieux de vie. L’équipe de notre atelier d’architectes avait tenu à engager dès les tous débuts,
un dialogue permanent avec la RATP et les usagers.
Même dans nos démocraties, de flagrantes inégalités sociales subsistent et les ressources et services de nos villes contemporaines ne peuvent pas être égalitaire-ment partagés par l’ensemble de la population. Nous ne prétendons pas qu’un réseau de transports en commun - métro, autobus, tramways -voire de « tuk-tuk » et rickshaws comme ailleurs dans le mondes, puisse régler les problèmes d’inégalités sociales. Une accessibilité facile et qualitativement meilleure à la ville entière peut être un engagement politique conséquent et une étape permettant d’alléger ce qui s’impose autrement comme une discrimination sociale et économique.
Cette démarche ambitieuse entend faire la démonstration qu’un métro, tel un édifice public, conçu souvent à partir de critères essentiellement fonctionnels, peut devenir un espace public convivial, et un lieu générateur de symboles et de réelle urbanité.
En interprétant la trame urbaine, l’équipe architecturale a souhaité faire de la déambulation souterraine un univers sécurisant. Chaque élément important du parcours baigne dans une intensité lumineuse. L’usage de verre et de béton poli, du fait de leur capacité à refléter la lumière, rappelle dans un langage contemporain la qualité de scintillement des carreaux biseautés de l’histoire du métro parisien. Partout la lumière, directe ou indirecte, cherche à rendre le déplacement lisible, intelligible et accueillant, pour se faire ainsi “matière architecturale”. Elle dessine et procure à chaque espace une ambiance particulière, sculptant les volumes, “théâtralisant” les différents itinéraires.
Dès le début de notre intervention, nous avons proposé que soit instituée une méthodologie claire, avec la mise en place de pratiques interactives et transversales. C’est dans cet esprit que nous avons rédigé la Charte Architecturale qui devait constituer un premier document de programmation et de synthèse qui servirait de référence tout au long du projet.
Pour beaucoup, les grands équipements, les sous-sols, les profondeurs, sont vécus comme des moments de stress au quotidien. Le souci de concevoir des lieux sereins, les plus “non agressifs” possible, a été dans la Charte notre préoccupation majeure au premier jour :
“Le trajet devrait être un événement. On devrait pouvoir faire du transport, du parcours en métro “un voyage”...
A ce jour, lorsqu’on prend le train, l’avion, le bateau comme ce fut le cas, il y a une certaine forme d’expectative, de plaisir. Même les parcours en autobus, en automobile peuvent avoir cette qualité, alors que le métro est essentiellement lié au quotidien.
Dans le réseau actuel, les réels événements du trajet se situent dans les tronçons aériens du métro. Ces moments forts transforment les voyageurs en spectateurs de la ville et mettent le métro en liaison avec le temps, les saisons et la lumière naturelle, tellement appréciée. La station de la Bastille, ouverte sur la Seine, est un événement dans le trajet du métro.
Les accès, les circulations verticales, les salles des échanges...autant de lieux à étudier architecturalement afin de dégager de “beaux volumes”. On peut par exemple faire pénétrer la lumière naturelle ou travailler la lumière artificielle. Les tunnels pourraient être éclairés de manière ponctuelle de façon à mettre en valeur leur morphologie complexe, surtout lorsque les voyageurs pourront se placer au devant du train ( qui devrait obligatoirement être vitré ).
La liste est longue de tous les éléments architecturaux et d’ambiance qui doivent contribuer à imprimer au parcours des voyageurs une sensation de voyage. A titre d’exemple : un tronçon du parcours en aérien, une station éclairée par la lumière naturelle, l’aménagement d’une partie du tunnel.”
Vision commune
Jusqu’à une période récente, aux quatre coins du globe, des plus petits hameaux aux grandes agglomérations, chaque environnement bâti par l’homme avait sa cohérence propre. Il existait des visions spatiales communes qui en faisaient des lieux spécifiques. Suite à des efforts créatifs et constructifs successifs, on s’acheminait vers des manières de faire, éventuellement des styles qui sont la matérialisation spatiale de forces multiples représentant la trame et la chaîne d’une culture, d’une époque, d’un lieu.
Autour d’un réseau d’espaces publics consciemment constitué (ruelles, rues, places) s’organisent les constructions, certaines d’entre elles imprégnées plus particulièrement d’un contenu civique. A l’extérieur, cet la délimitation entre bâti et espace ouvert est clairement définie, une campagne soigneusement entretenue et protégée. Comme tel nous reconnaissons le cœur de nos villes. Chaque lieu a une fonction, une image, un nom : le quartier du marché, la place de l’église, la place de la mairie, le quartier Saint-Joseph, etc.
Puis l’industrialisation, et spécifiquement l’automobile, les voiries, défibrant ces agglomérations, les éventrent littéralement et sèment à tout vent ces tissus urbains si laborieusement élaborés. La vision commune, souvent sous-jacente ou instinctive, est éclatée, écartée de son bon sens individuel et collectif. Puis le dérapage s’accélère et l’aliénation est presque totale. On adhère à certains principes, verbalise sur d’autres et on agit en fonction du court terme.
En résulte un aménagement de très basse densité, dévoreur de terre, banlieues de lotissements à perte de vue et centres urbains tranchés par des voies rapides. On “pénètre”, “viabilise”,”meuble”, “tartine”, “remplit”, “consomme”, des expressions qui en disent long sur l’acte et l’art de bâtir en 1980. En tant que citoyen et professionnel, il m’est impossible de participer à une telle débâcle.
La volonté d’aboutir
Cette pauvreté urbaine est le reflet de l’extrême complexité de nos sociétés. Elle est liée aux trop rapides mutations de nos modes de vie, de pensée, d’action, d’attentes et souhaits contradictoires. Nous sommes pris au dépourvu, souvent dépassés, incapables de freiner ce type de développement.
Mais cette pauvreté est aussi en partie due à notre non volonté de prendre le recul nécessaire pour marquer le pas et réfléchir aux possibilités de créer un milieu propre à notre culture. Nous devons nous donner les moyens de créer un environnement qui a un sens, une signification symbolique, fonctionnelle, opérationnelle.
Il est impératif pour chaque individu et chaque collectivité de tenter de clarifier ses buts et aspirations pour les insérer en un continuum urbanistique, une imbrication successive d’échelles, à la manière des poupées russes : rue, quartier, commune, région.
Ceci nous amène à une première visualisation de directions possibles, de choix à discuter, évaluer, d’éléments clés à réaliser. Une étape qui n’est ni longue, ni coûteuse, ni proliférante en paperasses, bien au contraire. Il s’agir d’utiliser des outils d’étude clairs et succincts (sans jargon), maquettes de quartier, dessins et perspectives, mais aussi projection budgétaire.
Dans de nombreux pays, depuis bien des années, toutes les propositions d’urbanisme sont accompagnées de planning, de coûts d’investissement, de gestion, éléments qui sont intégrés, lors de l’acceptation du projet, dans le budget municipal et intercommunal.
La qualité urbaine
Sans vouloir mettre en cause l’importance d’une meilleure vision architecturale au niveau du projet, il faut constater que l’enjeu réel de notre environnement est à l’échelle de l’habitat et de l’urbanité au sens large. Balance à trouver entre sens et non-sens de nos civilisations contemporaines. Balance à rétablir entre bâti et espaces naturels : poumons écologiques mais aussi économiques et culturels.
Quel est pour les années 80 le véritable langage urbain ? Quel rôle et quelle forme donner au travail, aux loisirs, à la culture, aux communications, qualitativement et spatialement dans un premier temps, mais presque simultanément sur le plan quantitatif et économique ? Il est aisé de remplir le COS, “tartiner” et bâtir plus que la commune voisine, avoir sa “pénétrante”..., mais pour y faire quoi, pour venir d’où, pour aller où, et ceci en utilisant les justes moyens et pas les normes d’hier ou d’avant-hier.
La volonté de faire face
Il est aisé de lancer quelques platitudes, de grands desseins, sans se donner les moyens législatifs et économiques permettant de mettre en pratique un programme. Il est tout aussi démagogique de ne pas assumer ses responsabilités comme citoyen, professionnel, élu, en se reportant sur autrui. Nous pouvons aujourd’hui créer un environnement de qualité. Cela implique par contre de la part de chacun d’entre nous un minimum de convergences, d’actions communes et cohérentes. Par rapport au tissu urbain par exemple, construire uniquement en continuité avec l’existant, concentrer au maximum mais de façon compatible avec les besoins, intégrer à l’habitat la complexité des activités du travail, des loisirs, créer un réel maillage d’espaces verts qui s’infiltrent dans toutes les fibres du tissu mais reliés aussi aux grands espaces naturels ; puis, en dernier ressort, réaliser un réseau de voiries qui desserve ces lieux de vie. C’est effectivement une démarche qui se démarque de certaines des pratiques actuelles, mais en continuité avec celles pratiquées depuis des générations.
Les moyens
Les différents documents d’urbanisme sont des étapes importantes vers une clarification d’objectifs. Par contre, ils restent essentiellement des documents juridiques et non des outils d’aménagement.
Ils n’intègrent pas une traduction graphique d’intentions urbaines, d’implications financières, de coûts sociaux, d’investissement, de gestion, de priorités dans le temps. Ils devraient donner suite à des réflexions plus qualitatives tout en intégrant une responsabilité d’actions communales, départementales...
Il paraît impératif d’élaborer des documents et schémas de structure par quartiers, secteurs, communes. On peut visualiser deux ou trois “futurs possibles”, utilisant un langage clair et précis, qui présentent aux élus et aux citoyens des directions à envisager, des choix à effectuer, des investissements à programmer.
Essentiellement non réglementaires dans un premier temps, ces plans peuvent être conçus comme des chartes d’intentions. Ces études peuvent être menées, par exemple, par le biais d’ateliers d’urbanisme municipaux, par groupements de communes, ou restreints à un quartier ou un secteur donné.
Mais la question reste posée : allons-nous nous donner les moyens de trouver un sens à notre environnement ?

5. L’architecture participative
Texte de présentation
- L’école Decroly, avec le témoignage de Ruth Kohn
- Le Buisson Saint-Louis, avec le témoignage de deux habitants + article sur le BSL, 1984
- Annexe : Entretien Grenoble, 1986
“L’architecture est trop importante pour être laissée aux seuls architectes”
Giancarlo De Carlo
Vivre avec, c’est le fondement de l’architecture participative, à condition de rester lucide et de ne pas se laisser embarquer n’importe où. Cette démarche est intervenue au tout début de ma vie professionnelle, avec la maison que j’ai conçue en Floride en vivant trois mois chez mes premiers clients, les Walborsky. C’était la fille du marchand de bois ami de mon père. Je devais avoir 25 ans. Je travaillais à mi-temps chez un architecte, le matin pour lui et l’après-midi sur toutes les études préparatoires et la réalisation des plans de la maison. Puis, engagé dans l’armée pour deux ans, je n’ai pu suivre le chantier qu’occasionnellement. Mais pendant toute la période d’élaboration du projet, étant hébergé par mes clients pour être plus proches d’eux, dès le petit déjeuner, on parlait de la future maison. On discutait au jour le jour devant les dessins et les choses évoluaient au fur et à mesure. Lorsque nous étions ensemble, nous ne pensions plus qu’à ça. C’était très prenant.
Les habitants, quand ils sont trop en demande, peuvent devenir dépendants de nous, à la manière des patients en psychanalyse. C’est vrai qu’il existe une forme de “transfert” en architecture aussi.
Quand on fait une maison pour quelqu’un d’autre, on est à son écoute et en même temps on filtre, on essaie d’interpréter ce qu’il dit, on le pousse parfois jusqu’à ses derniers retranchements afin de faire apparaître des contradictions, des désirs inconscients qu’il n’avait pas exprimés au premier abord. Alors on commence à éprouver de la sympathie pour lui et réciproquement. Puis, quand la maison commence à se construire, à un certain moment, tout peut retomber, sans parler des mois difficiles, comme pour n’importe quel déménagement, lorsque la vie quotidienne dans ce nouveau lieu démarre...
Mais au départ, il tombe amoureux de l’architecte...
C’est une drôle de responsabilité de travailler avec l’humain, dedans et dehors. C’est forcément pluridisciplinaire, cela touche à la fois à la psychologie, la sociologie, la pédagogie, l’économie, l’écologie, l’esthétique. A la chair et à la pierre. C’est foisonnant et complexe. Et il faut faire du client un allié. C’est une forme de séduction.
Comment faciliter la participation des habitants ? En partant de structures simples, d’un détail de la vie quotidienne. Il faut amener les gens très lentement vers la ou les solutions appropriées. Il faut que le projet parle, leur parle. Il ne faut pas les braquer, les brusquer. Apprendre aux gens à habiter avec le maximum de bien-être, de beauté et de fonctionnalité, c’est un sacré métier. Je pense à cette femme, par exemple, qui veut aménager une pièce pour écrire. Elle a un désir qu’elle arrive mal à exprimer au départ. Alors je lui pose des questions sur sa manière de vivre, sur ses enfants, etc. C’est comme une enquête, ou un jeu urbain à usage privé, un jeu de simulations pour faire parler l’inconscient. Il faut arriver à concevoir un lieu approprié à une fonction en y incluant une perspective d’évolution à l’intérieur, élargir les possibilités de transformation ultérieure, quand la belle-mère débarque, quand les enfants grandissent, quand le couple s’autonomise, change son mode de relation, etc.
Le lieu est important mais ce sont les gens qui font vivre le lieu. Ils peuvent l’exalter, le détourner, ou le détruire. La plupart du temps, le projet est mal interprété parce qu’on les inquiète, on bouscule leurs habitudes, on les oblige à se remettre en question, ils pensent qu’on les utilise, eux et leur espace, à des fins personnelles, en réalité ils ont peur du métier d’architecte, parce qu’ils le connaissent mal, approximativement, ou ont des a-prioris.
Souvent, le client ou maître d’ouvrage, est une institution, représentée par un « groupe de pilotage », ou par une seule personne qui, pour de multiples raisons, n’a pas envie de se compliquer la vie, car un architecte est souvent perçu comme un trouble fête. Ce client « institutionnel » peut aussi substituer ses points de vue personnels, consciemment ou inconsciemment, à une réelle réflexion collective que sa fonction exige. C’est pourquoi, dans ces cas-là, nous avons souvent recours à des démarches participatives, qui impliquent d’élargir les partenaires de la maîtrise d’ouvrage vers les futurs utilisateurs.
Même si ces futurs utilisateurs risquent de ne plus êtres présents lors de la réalisation du projet, compte tenu des délais entre conception et réalisation, ce dialogue permet d’élargir le programme, de le complexifier, et d’apporter ainsi des réponses architecturales ou urbanistiques plus “amples”. Je prends souvent l’exemple d’une chemise qui serait exactement ajustée à la taille du programme, de la demande, je lui préfère une chemise indienne (courta) plus fluide, plus grande, qui permet des ajustements, des adaptations de dernière minute.
Toute architecture, potentiellement est sujet à être “participative”. C'est une question de volonté de part et d'autre entre un architecte et ses « clients », qui partagent ou pas le regard porté vers l’autre et les autres pour améliorer le cadre de vie autour de nous. L’architecture n’est pas seulement spatiale, elle a aussi une forte dimension sociale, avec une obligation d'engagement, de positionnement et de crédibilité politique.
Après, dans la démarche, vient une phase que l’on pourrait qualifier de “pédagogique” : avec l’élaboration de carnets de bord, de chartes d’objectifs, avec l’utilisation de schémas explicatifs, de maquettes qui permettent de mieux visualiser les possibilités, avec bien entendu l’écoute des habitants, la rencontre du client. Mais on peut aussi être architecte sans trop s’impliquer avec le client, qui est souvent considéré comme un gêneur... La majorité des architectes ne se préoccupent généralement pas trop des usagers, des habitants.
Avoir une démarche participative ne veut absolument pas dire pour moi que l’architecte est uniquement le scribe de la demande de ses clients, comme les scribes qui écrivent des lettres sous les arcades des villes du Moyen-Orient. J’affiche mon point de vue, mes propres préjugés aussi.
Je suis totalement partie prenante dans ce qui est en jeu, en enjeu. Il s’agit en fait de partager des idées aux uns et aux autres, que les deux parties soient partenaires. Parfois cela se complique quand le projet est institutionnel, collectif, avec plusieurs interlocuteurs. Arriver à réaliser un projet est une vraie aventure. C’est tout un art de se mettre à la place de l’autre, des autres, de leur insuffler sa vision des choses, ou tout au moins de les amener à l’entrevoir, et bien évidemment en respectant scrupuleusement les leurs.
Dans plusieurs projets, j’ai poursuivi, à des degrés divers, des démarches participatives adaptées au contexte social et environnemental. Ce fut le cas d'une forme de symbiose totale avec un couple devenu amis pour la maison Walborsky en Floride, le Buisson-Saint-Louis à Paris, l’école Decroly à Saint-Mandé). Puis, « autrement » dans l’élaboration de deux projets d’HLM, à Yzeure (près de Moulin), et à Gennevilliers. Enfin dans une approche de plus contextuelle avec le client maître d’ouvrage (le métro Météor à Paris, le projet HLM Anatole France à Grenoble).
L’Ecole Decroly
L’école Decroly est l’exemple, presque unique en France, d’une école publique de trois cents jeunes de la maternelle à la troisième, où est pratiquée une pédagogique active, avec une grande participation des parents. Elle est dirigée par deux “animateurs” (et non “directeurs”) choisis parmi les enseignants, et qui se renouvellent, un à la fois chaque année.
L’école Decroly fonctionnait alors comme école d’application de l’école normale d’Auteuil. Localisée à Saint-mandé, proche du Bois de Vincennes, elle était néanmoins gérée par la ville de Paris, ce qui rendait sa situation relativement complexe. Elle était également perçue comme un élément perturbateur, voire plutôt “gauchiste”, aussi bien par certains riverains que par la ville de Saint-Mandé et la ville de Paris.
Il était question de rassembler et d’agrandir les locaux qui comprenaient à l’époque un ancien et beau pavillon et plusieurs préfabriqués. Nous disposions d’un budget relativement limité et le projet que nous avons réalisé dépassait à peine cette enveloppe. Pendant presque deux ans, dans une toute petite remise du jardin de l’école, on a travaillé « devant » les enfants et les enseignants avec dessins, plans, maquettes, et une démarche de programmation clairement affichée. Notre projet aménageait en douceur le pavillon existant, et autour d’un espace commun spacieux, s’organisait en large demi-cercle un nouveau bâtiment sur trois niveaux, en retrait les uns des autres, dégageant de nombreuses terrasses pour les classes en étage.
L’administration de la ville de Paris nous accusa, à tort, d’avoir réalisé un projet bien trop ambitieux et onéreux, et malgré les protestations de l’ensemble des parents, enfants, enseignants, le projet fut abandonné.
Par la suite, et bien des années après, le projet fut repris par le département du Val de Marne, sans prendre en compte l’énorme travail que nous avions réalisé. Un projet tout ce qu'il y a de plus banal fut réalisé.
Ruth Kohn, à propos de l’école Decroly
“Je suis dans l’éducation nouvelle. Toute mon expérience à New-York et en Inde était dans cette perspective là. Quand on est arrivé en France, en 1979, il était donc impossible pour moi de mettre les enfants dans une école traditionnelle française. C’est en explorant une quarantaine d’établissements scolaires de la région parisienne que je suis tombée sur Decroly, une école publique gratuite, réservée à certains enfants choisis par les enseignants et les parents d’élèves sur dossier. C’est pour cela qu’on a déménagé à Saint-Mandé. L’école nous convenait aussi bien du point de vue de la philosophie, de la méthode, que de l’ environnement, des parents, etc.
Decroly est un chercheur en sciences de l’éducation, un philosophe belge qui a créé une méthodologie fondée sur les centres d’intérêt de l’enfant, et progressive avec l’âge. Toutes les matières étudiées sont centrées sur un thème donné (le Moyen-Age, un animal, etc.) Chaque élève mène parallèlement un travail indépendant de recherche, enquête, réflexion, tout en respectant le programme. Il y a une seule classe par niveau. Cela constitue une petite famille, qui peut parfois devenir étouffante. On a rencontré des parents qui sont devenus des amis, on a été très actifs comme parents d’élèves.
Finalement, il a été question de rénover l’école. On a lancé une grande enquête. On était un petit comité de parents avec les deux architectes, Max Hetzberg et Bernard. On a demandé à tout le monde, parents, enseignants, enfants : qu’est-ce que vous aimez dans l’école actuelle et qu’aimeriez-vous pour un nouvel espace sur le même terrain ? Ça a pris beaucoup de temps, et au fur et à mesure qu’on avançait, avec l’aide d’un laboratoire de géographie, on a constitué des tableaux à double entrée, avec des cartes perforées. On a abouti à un véritable cahier des charges et les architectes se sont mis au travail. Ils ont fait une maquette d’un bâtiment en courbe, très beau, et tout ça dans l’enceinte de l’école. Bernard faisait jouer tout le monde, enseignants, parents et enfants autour de la maquette. Et finalement, le projet n’a pas été accepté. Mais cela reste une belle expérience de pédagogie participative.”
Le Buisson Saint-Louis
C’est l’illustration, la mise en œuvre exemplaire de la notion d’architecture participative. C’est à la fois un rêve d’architecte et un rêve d’habitants : inventer ensemble la maison “idéale” de chacun. Les futurs habitants ont d’abord choisi un lieu, puis un architecte pour interpréter leurs désirs. Travail long, passionnant, où chacun rassemble, à la demande de l’architecte, sur du papier kraft, des photos de détail ou d’ambiance, d’objets ou de lieux aimés. Travail en groupe et en atelier, de dessins, de simulation en maquettes.
C’est un projet à la fois “daté”, inscrit dans l’air du temps de ceux qui ont vécu 68 et qui ont voulu prendre leurs désirs pour en faire une réalité, mais cette utopie réalisée est aussi quelque chose de récurrent dans l’art et la manière d’habiter au cours des siècles, de l’abbaye de Thélème au phalanstère de Fourrier.
C’est une “île” entre Belleville et République, un îlot sur l’emplacement d’un lavoir industriel du XIXe siècle, un petit paradis, un bel objet, un anti-ghetto idéologique et un lieu clos en même temps, isolé au milieu du quartier populaire et cosmopolite qui l’entoure, qui lui n’a cessé de bouger socialement et de se paupériser.
Qu’en est-il 20 ans après ? Le temps d’une génération qui y est née et y a grandi. Les jeunes ont l’air heureux et n’ont pas envie de quitter les lieux. Les parents qui ont fait l’apprentissage de l’autogestion, qui ont du affronter le dur désir de durer en se confrontant aux problèmes de fonctionnement et d’entretien, n’ont pas l’air mécontent non plus de vivre ici, puisqu’aucun n’est parti.
“C’est plus qu’un investissement financier, ce sont nos tripes qui sont là”, dit l’un des habitants. On ne peut pas quitter le bateau comme ça. Alors, c’est à la vie, à la mort ? Et après ?
C’est une sorte de bateau-lavoir, vaste et compact, un montage très savant et très ludique, un labyrinthe d’appartements encastrés les uns dans les autres, aux façades presqu’entièrement vitrées, donnant sur des espaces intérieurs-extérieurs, courettes, patio, jardin, plan d’eau, escaliers, paliers, colonnes, coursives, terrasses, rampes, allée centrale, coins et recoins dignes d’un vrai terrain d’aventure pour tous usages et tous les âges.
N’y a-t-il pas le danger que ce lieu où il a l’air de faire si bon vivre, où l’on se sent si bien, ne puisse le rester qu’à condition d’être coupé du dehors et ne devienne par la force des choses une “gated community” à petite échelle ?
Tout est inscrit ici, il y a des traces de toute l’histoire, des récits, des photos de chantier, des albums de fêtes en famille, entre amis, le journal de bord des réunions, il y a surtout le vécu de 20 ans de vie, de la chair, du vif à saisir.
Aujourd’hui où l’on parle de “démocratie participative”, de renaissance des “individualités collectives”, d’alternatives aux manières de penser, de vivre et d’habiter le monde, pourquoi ne pas aller voir de plus près, faire la radiographie de cette expérience d’architecture “participative” pleine de sens et d’humanité ?
Le Buisson Saint-Louis, Paris X
S.C.P. “Le lavoir du Buisson Saint-Louis”
- Bernard Kohn, architecte
- Dominique Tessier, assistant (maintenant architecte indépendant).
- Ove Arup, bureau d’étude
- Socotec, bureau de contrôle
- Georges Rouch, acousticien
Ensemble de 14 logements P.a.p : 2 triplex, de 150 et 140 m2, 10 duplex de 33 à 145 m2, 2 logements de plain-pied de 95 et 50 m2
Un cabinet médical, un local commun
La reconversion d’un bâtiment industriel en cœur d’ilôt conduisait à concevoir une structure complexe spatialement et fonctionnellement. La conservation du bâti était une nécessité pour la préservation des droits acquis (vues, surfaces, enveloppes) ; elle a induit la manière de construire elle-même.
Les règlements d’urbanisme nécessitaient le maintien d’activités, ce qui étayait heureusement l’urbanité introduite par le tracé d’un passage de la rue du Buisson Saint-Louis à la rue du Faubourg du Temple. Né d’une nécessité fonctionnelle pour permettre l’accès à tous les lieux, le passage est devenu l’axe d’appartenance sur lequel s’articulent les espaces collectifs et privés du projet. Le traitement de cette épine dorsale est en brique et en béton coloré rouge. Il y a un tissage entre le langage “public” maçonnerie-brique et le langage plus individuel du bois, qui préexistait dans la structure originelle du bâtiment.
L’axe symbolique apporte à l’axe économique une dimension naturelle. C’est le lien “terre-ciel”, “ombre-lumière”. Le premier axe est formalisé dans le projet en continuité avec les espaces rues, le second par une cour hexagonale recevant et distribuant la lumière, implantée au-dessus d’un puits, trace souterraine et invisible de l’ancien bâtiment et de son activité (lavoir).
Il y a une continuité de pensée et de fabrication dans la conception et l’implantation du bâtiment dans la ville et du logement dans le bâtiment.
La fragmentation des lieux ici n’existe pas, l’unité du dehors et du dedans est d’abord exprimée par la permissivité donnée aux regards. La transparence est poussée aux limites de l’intime, et les pièces se prolongent sur les paliers, cours, terrasses, ou bow-windows permettant à l’habitant de se resituer à l’intérieur de l’îlot et dans le bâtiment, à la verticale, à l’horizontale, et en diagonale.
Les espaces internes du projet sont toujours inscrits dans une séquence, pensés en fonction de leur rapport à ce qui les précède ou les suit, et ceci dans les trois dimensions.
L’addition, la superposition des pièces, ordonnancées par le rythme constructif sont multiples. Les logements se croisent, s’imbriquent dans un même bâtiment ou d’un bâtiment à l’autre, jouent également sur la hauteur.
Chaque volume dispose de multiples orientations, et de qualité de lumière et de vues. La trame constructive de 3m x 3m a facilité cette souplesse volumétrique et cette répartition des logements.
La volonté architecturale de garder une flexibilité dans la conception et dans le temps, le souhait de transparence, de variété volumétriques ont été des raisons majeures dans le maintien d’une structure poteaux/poutres.
Les menuiseries sont toutes avec impostes vitrées pour une meilleure appréhension des espaces intérieurs, une meilleure pénétration de la lumière. Les façades ont été travaillées en épaisseur pour donner des possibilités d’habiter, de poser des objets, s’accouder, affirmer la présence d’un mur composé de matériaux légers
La lisibilité de la structure ainsi que celle du dessin des détails constructifs participent d’un souci constant de dire comment le bâtiment a été façonné. C’est utiliser la construction comme élément pédagogique : “voici comment j’ai été conçu, construit...”
Dominique Remy, habitante du BSL
“Je fais partie de la première vague des occupants, autour de deux couples “initiateurs”: Une première expérience autour d’un groupe de dix, douze personnes s’est d’abord réuni tous les mois pendant un an pour se féliciter de ce que serait notre vie en yoga et en laine violette tricotée sur métiers artisanaux. Le jour où on a trouvé un terrain, près des Buttes Chaumont, il n’y avait plus personne pour l’acheter et se mettre au travail. Ce premier essai a été intéressant parce qu’il nous a appris qu’il ne fallait pas commencer par discuter sur le rêve, mais par trouver le lieu. De cette première tentative ont subsisté deux couples. Quand Catherine (Gauthier) a trouvé un terrain dans le Figaro, on a reconstitué un groupe dont les critères étaient : une vie collective, toujours, mais sur cet espace et dans ce quartier.
Comment est-on entré en contact avec Bernard ? Je me souviens qu’à l’époque il s’occupait d’un projet d’école expérimentale, est-ce par ce biais ? Il y a eu plusieurs hypothèses, plusieurs candidats... Au sein de notre groupe, il y avait un couple d’architectes, Jean-Paul et Francine Philippon. Ils ont fait des choses très belles, le musée de Quimper, le musée d’Orsay. On a même récupéré ici des baignoires et des lavabos de l’ancien musée d’Orsay... Bien que leur amie depuis, je me suis battue contre leur candidature. Cela créait un déséquilibre. On ne peut être juge et partie. On a abandonné cette piste.
Je crois que ce qui l’a emporté dans le choix de Bernard Kohn, c’est son côté “démagogique” mais sans notion péjorative, je dirais plutôt sa conviction participative. Je me souviens qu’il nous avait demandé d’apporter des objets, des photos de ce que l’on aime, de ce qu’on aimerait voir chez nous. Philippon voulait avoir sa chambre, sa salle de bain et une cheminée dans le même espace, moi j’ai apporté des photos de mes chats. Il nous a demandé à chacun, pour la constitution des lots, compte tenu des prévisions, des éléments très personnels, de l’ordre de l’intime. On a constitué nos lots avec des bouts de papier kraft collés et assemblés dans lesquels les photos étaient insérées. Ce n’était pas encore des maquettes. C’était l’organisation de l’appartement idéal, des carrés de kraft à moduler. C’est cette démarche là qui a été la plus décisive. Et puis, Bernard a un côté “loukoum” charmant, caressant, pas du tout paternaliste ni dominateur, tout cela a joué dans le choix.
Ce qui a beaucoup joué aussi, c’est son expérience indienne. Il nous avait montré ce qu’il avait fait avec Kahn, les catalogues des constructions de Kahn, l’utilisation de la brique, le mélange brique-bois. Il y avait un imaginaire qu’il a contribué à installer, fait à la fois du “zen” indien et de l’influence de Kahn. Je me souviens d’un bâtiment de Kahn en brique qui donnait sur l’eau, qui se reflétait dans l’eau, très beau. Tout cela a forgé une ambiance propice à la réalisation de nos envies.
Je sais que ses relations avec certains d’entre nous n’ont pas été formidables par la suite, dans la gestion du chantier. Moi, j’étais chargée de suivre le chantier. On m’appelait “l’archi-traître”, j’étais la représentante du groupe auprès de l’architecte, mais, auprès du groupe, j’étais la porte-parole des impératifs techniques et des contraintes de l’architecte... donc je trahissais les habitants.
Au début, son agence était dans le lavoir, puis, quand il s’est installé à Saint-Mandé, il a délégué un architecte de son équipe, Dominique Tessier, pour la conduite technique du chantier. Bernard ne présidait plus qu’ à la confection de l’ensemble.
On a acheté le terrain en 1979 et on a emménagé en 1983.
Bernard a un grand calme et une grande détermination. Et c’est vrai qu’à l’intérieur d’un groupe tiraillé par des incertitudes, des rivalités, des conflits d’intérêt, il a beaucoup contribué à apaiser les choses et à régler les conflits, même indirectement. Le fait qu’il y ait eu dans le groupe des architectes et des urbanistes a joué. Son charme de grand professionnel, d’esthète, d’homme d’expériences multiculturelles a contribué à ce choix.
Notre projet de vie lié à cet endroit est complètement inscrit dans l’idéologie d’une époque, il est emblématique d’un repli de post soixante-huitards sur l’individuel. J’en suis convaincue. Notre premier projet était constitué autour de gens qui avaient tous “fait” 68. Le groupe d’ici est composé à la fois de militantes féministes ( Marie, Séréna, Sylvie, ex-”carabosses” ) et d’un pôle de cathos de gauche ( Micheau, Courault, Brau )
Au départ, nous étions constitués en société civile immobilière, transformée en 1990 en copropriété banale, avec syndic. La solidarité financière n’existe plus. Symboliquement, c’est un grand changement. Mais il reste une grande fidélité finalement. La preuve de la réussite de cette expérience c’est que personne n’est parti. Seuls les Philippon ont quitté les lieux avant même la fin du chantier, et Martine Bour, la seule célibataire du groupe. Tous les autres ont poussé les murs quand les enfants sont arrivés, plutôt que de partir.
La gestion des enfants ici est géniale. Les enfants sont très attachés à ce lieu : la salle commune, la garde alternée des enfants, les cours d’anglais, les sorties, les goûters. Pendant longtemps il y a eu une fluidité entre les enfants : ou je n’avais personne à dîner, ou j’en avais six. Voir les enfants entre eux, circulant d’un appartement à l’autre, utilisant les coins et les recoins, dedans, dehors, c’est un vrai bonheur. Ce qui a compté, c’est la fréquentation d’autres adultes que les parents, d’autres sources d’autorité, avec d’autres fonctionnements. Cette socialisation intergénérationnelle a eu un effet bénéfique pour mes enfants. Ils ont un rapport avec les adultes très chouette.
Je n’ai pas complètement le sentiment de vivre dans la maison de mes rêves. D’abord parce que j’ai fait des erreurs et parce qu’il y a eu des contraintes techniques et financières. On est pourtant arrivé avec Bernard à une optimisation de la contradiction rêve/contraintes : il a réussi à autoriser les rêves architecturaux les plus fous de chacun d’entre nous. Il a été extraordinairement conciliant. Chez les Courreaux et chez les Brau, ils voulaient tous être au Sud. Il fallait faire un escalier croisé, il s’est arrangé pour que cela soit possible architecturalement. Il a résolu aussi l’installation de gonds extérieurs aux fenêtres.
20 ans après ? Quelles sont les erreurs qui 20 ans après plombent ma vie ? Franchement, je ne vois pas. Il y en a qui sont obsédés par le bruit des voisins. La seule façon de régler ce problème disait Bernard, c’est de vous entendre. Il avait complètement raison. La promiscuité visuelle et phonique que ce type d’habitat suppose ne peut être réglée que par l’indulgence de l’amitié.
Certains de ses choix architecturaux comme les façades de verre, l’utilisation du bois étaient guidés par une volonté esthétique. En lui-même, il est beau cet îlot. Ghislaine est furieuse, elle, parce qu’il n’y a aucune protection sonore entre son appartement et la salle commune. Chaque fois qu’il y a une fête... Bon. Il faut savoir ce que l’on veut.
Si c’était à refaire ? Je recommencerais avec des règles de participation plus claires. Au fond du jardin, c’est un peu raté, après bien des conflits. Au départ, il devait y avoir une percée, une idée de Bernard à laquelle on a été majoritairement opposés. L’idée du passage public, cela voulait dire que c’était une rue, que c’était impossible à négocier avec la ville de Paris et les autres immeubles attenant.
Aujourd’hui, si c’était à refaire, je recommencerais parce que je crois à la qualité de vie que cela génère. Avec l’âge, on se sent moins impliqué collectivement, mais ce qui me fait dire ça aujourd’hui encore, c’est la conviction que cela peut conduire à un bel objet ; c’est moins la qualité de vie collective que la conviction qu’un bel objet ne peut passer que par cette démarche ( avec un architecte et un collectif ).
Bernard fait partie de ce lieu, et pourtant il avait des scrupules à revenir ici, avec la peur qu’on l’engueule. Il avait le souvenir d’une hargne à son égard que je ne comprends pas, que je n’ai jamais éprouvée. Il a été étonné de la chaleur avec laquelle il a été accueilli et j’espère qu’il viendra à la fête des 20 ans de l’îlot.
Il nous a imposé certaines choses au nom du “genius loci”, mais il fait partie du “genius loci”. On ne peut dissocier la personnalité de Bernard de cet objet, et de ce qu’on en a fait. On a été très respectueux du lieu par l’entretien qu’on lui consacre. Ce bâtiment est une vraie Rolls. Cela coûte très cher. Il y a une vraie erreur : les structures en alu n’isolent ni du froid, ni de la chaleur. Il y a un pont thermique d’enfer...
C’est un bel objet, un îlot dans un environnement plutôt pauvre, déshérité, populaire. Je ne pense pas qu’il y ait une véritable intégration. Mes enfants ont été à l’école dans le quartier, mais il y a eu des agressions. Ma fille Jeanne, blonde aux yeux bleus, s’est retrouvée trois fois à l’hôpital. Elles ont fini à l’école privée. C’était trop compliqué à gérer. L’école n’a donc pas été un facteur d’intégration au quartier, d’autant plus que les enfants de l’îlot vivaient en groupe, étaient “ghettoïsés” en quelque sorte.
Beaucoup de ceux qui vivent ici sont réticents au quartier. Moi j’adore. On trouve tous les produits du monde entier. Il y a un brassage de cultures fantastique. D’ici au métro, on croise au moins dix nationalités.
Cet îlot est le point de départ d’un embourgeoisement du quartier. La cour des Bretons, à côté, avec show-rooms, designers, en est le symbole. Tous ces cours avec artisans, imprimeurs, sont en train de changer. Cela dit, deux cambriolages chez nous en quinze ans, c’est peu. On ne peut pas dire qu’il y ait fusion-intégration, mais il n’y a pas de rejet non plus.
Entre la personnalité de Bernard et le quartier, il y a des connivences. Ce serait intéressant de savoir si cela a joué pour lui. Il y avait surtout chez Bernard un désir d’architecture participative. A-t-il continué par la suite ? Je crois savoir qu’ il a fait un chantier avec la participation d’un autre type de population, à Moulins. Ce n’était pas des petits bourgeois propriétaires comme nous, mais des locataires de HLM, comme l’aboutissement d’une démarche idéologique et non économique. Je me demande comment, dans les commandes publiques ( ambassade, cité judiciaire, métro) il a géré cette dimension participative, parce que je pense que cela fait partie intégrante de sa démarche, il ne construit pas juste pour faire un objet, voire un bel objet, il construit pour que ce soit habitable, habité, utilisé, vivant.
Il y a plusieurs facettes chez Bernard, mais je crois que c’est la tendresse qui l’emporte, et la finesse. Je l’associe beaucoup à la danse (une de ses filles est danseuse), à l’Inde, au raffinement. Et puis, il est très attaché au détail, ce qui est le critère de l’élégance.
Et tout ça enrobé dans l’immense complexité que représente le fait d’être juif dans la société française. Quand il raconte comment il a été élu, avec le maximum de voix, aux dernières élections municipales dans le petit village de l’Hérault où il habite, et comment il s’est effondré sur les genoux de son amie en disant “mais pourquoi ils ont voulu d’un petit juif comme moi”, c’est à la fois rien et c’est en même temps tout Bernard. Il y a là une fragilité qui le rend très réceptif à la fragilité des autres... Vis à vis de nous tous, au Buisson Saint-Louis, il a été très accueillant, très empathique, très à l’écoute. C’est loin d’être un “petit juif”, c’est un grand bonhomme.”
“L’ île au cœur de l’ îlot”
par Marie-Christine Loriers, “Techniques et architecture”, 1984
A Belleville, rue du Buisson Saint-Louis, s’achève la reconversion d’un lavoir industriel : 14 logements bien contemporains s’articulent dans une vaste structure de bois du XIXe siècle. L’architecte Bernard Kohn et les habitants ont mené ensemble cette opération.
Jusque dans sa forme, le bâtiment exprime cette participation, ses accords et ses conflits. Maîtrise du projet et intégration des demandes des habitants s’y allient et s’y juxtaposent. Diversité des langages que semble unifier, en les tissant entre elles, la matière même du bâtiment, fait de bois, de brique et de parpaings, de béton et d’éléments industrialisés
Quelques colonies d’émigrés des milieux socioculturels nantis investissent les coquilles vides de l’industrie et de l’artisanat. De Bastille à République, et même au-delà des barrières, il est plutôt “branché” de s’installer sur ces terrains encore libres, meilleur marché qu’ailleurs. Ils échappent à la rigueur des règlements figés d’urbanisme. Ils présentent des occasions d’architecture différente.
A Belleville, la Zac est propre et nette, avec quelques années de retard et des occasions perdues pour l’architecture. Des urbanistes espèrent encore en la pérennité d’un tissu urbain vieux de plus d’un siècle, ténu, secret, avec de petits immeubles de moellons crépis, des passages étroits, des jardins où s’attardent les derniers cerisiers de la capitale. Tissu ici déchiré par les bulldozers, là taché par la misère, sale comme un chiffon. Dans ce Nord-Est de Paris, territoire du “grand projet d’aménagement” de la Mairie, tout est possible, tout commence aujourd’hui, la rénovation, la réhabilitation, le ravaudage en finesse, la spéculation aussi.
A deux pas de la Zac, rue du Faubourg du Temple, la caissière du supermarché fait semblant de marchander une boîte de poivrons. Belleville Beur, Belleville Afrique. Des épiceries offrent des légumes inconnus, petites raves violettes, vaisselle de joncs. Belleville Asie. Les trafiquants de drogue prospèrent. Belleville l’Héro.
Fin de chantier
Au métro Goncourt, la ville demeure petite-bourgeoise. La rue du Buisson Saint-Louis est en pente. A gauche, derrière les fenêtres murées, les dortoirs, le squat, les grues qui progressent. A droite, de meilleures façades, des porches, des passages ouvrant sur des cours, des ateliers, tout un urbanisme droit sorti de Zola. Il y a cinq ans, en 1979, au n° 8, dormait un lavoir industriel du XIXe siècle “structure de bois cachée sous une abondante chevelure de lierre” (Dominique Tessier, assistant de BK), emplissant presque entièrement le creux de l’îlot.
Aujourd’hui, un chantier s’achève. Le lavoir fait place à son double contemporain, années 80, un ensemble de logements articulés sur l’axe d’une trouée centrale incisée au cœur même du bâtiment. Rue intérieure pavée d’ocre rouge, façades modulées en panneaux d’amiante-ciment spécialement traitée, huisseries polychromes, seuils, escaliers nombreux, terrasses. Deux tronçons de colonnes de brique, irréguliers, râpeux, marquent l’accueil. Les voici redites sur toute la hauteur de la façade, posant en termes de monumentalité urbaine la question de la structure. Réponse immédiate : la structure du nouveau bâtiment est celle de l’ancien lavoir, vaste charpente de bois accueillant un usage nouveau, l’habitat.
Treize familles s’installent ( 9 couples, 4 célibataires, 11 enfants, professions libérales, hauts et moins hauts fonctionnaires pour la plupart, revenus annuels de 80 000 à 200 000 F). Ils disposent d’appartements en duplex ou en triplex. Ils ont choisi ce lieu, ce voisinage, ils ont décidé de leur architecte. Ils sont intervenus sur la conception de leur habitat. Bref, ce bâtiment est né de ce qu’il convient d’appeler “participation”. Bien que complexe dans sa forme et dans l’organisation des logements, il est unitaire dans son expression. D’évidence, il tient un seul propos d’architecture. Comment le multiple de l’usager et le singulier de l’architecte s’y sont accordés ?
“Des gens et un lieu pour vivre ensemble”
En 1978, un premier groupe de 4 personnes se constitue autour d’une volonté : vivre ensemble. En 1979, il se compose de 12 familles. L’achat du lavoir du Buisson Saint-Louis confronte le groupe au projet, au financement, aux premières difficultés concrètes : le terrain est constitué de deux parcelles en copropriétés différentes. Commence l’apprentissage, pour son acquisition, de la procédure, du montage financier, réglementaire et juridique, un apprentissage qui deviendra véritablement une compétence spécifique, faisant du groupe une société maître d’ouvrage (SCP, Société Civile de Production).
L’architecte Bernard Kohn a été choisi parmi une douzaine d’autres. Ce choix, selon les habitants et selon B.Kohn lui-même, relève de plusieurs facteurs : l’affectif, la séduction, l’esthétique et la raison. “Ils ont apprécié en moi une certaine expérience participative : un projet pour l’école de Decroly, l’antenne pédagogique de Pontoise, les ateliers publics de Coupvray, des lieux, des situations où des gens travaillent ensemble”. L’agence s’installe au Buisson Saint-Louis, convergence en un même lieu “des dires et des désirs, et du projet architectural”. Car tout autant, et même plus que les réunions hebdomadaires des habitants futurs, le construit du lieu suggère les orientations essentielles.
Tissu urbain, fils, nœuds, tissage...
Bernard Kohn trouve dans le tissu urbain le “fil conducteur du projet”, le passage sous le proche, à travers le bâtiment et au-delà, par les cours, vers la rue du Faubourg du Temple. Dans ce tissu, un nœud, physique et symbolique, la présence de l’eau, le puits de l’ancien lavoir. D’où le parti, selon Bernard Kohn de “recomposer le bâtiment le long de l’axe, d’y brancher les logements, de chercher le point fort par le creux, et d’en faire l’espace public des logements...”. “C’est à l’ emplacement même du cuvier du lavoir que se situe le patio, avec son plan d’eau, microcosme de la sociabilité du lavoir, comme, probablement, microcosme de la sociabilité du groupe “(Dominique Tessier).
Un lieu culturellement, intellectuellement référencé : “Je suis, dans tous mes bâtiments, dit Bernard Kohn, à la recherche d’un lieu symbolique, poétique, presque religieux”, un lieu où se reconnaissent les membres du groupe, qui se sont longuement interrogés sur la signification urbaine et sociale du projet. Cet axe directeur pour la composition du bâtiment impliquait une pratique de l’espace et une intervention en termes d’urbanisme : la traversée de l’îlot, l’itinéraire retrouvé de la rue du Buisson Saint-Louis à celle du Faubourg du Temple. Une perméabilité au quartier à laquelle s’identifiaient volontiers les membres du groupe, et qu’ils revendiquaient hier au nom de convictions socialistes, militantes ou conviviales. Aujourd’hui, le passage demeure encore fermé. Certains même s’interrogent sur l’opportunité d’y installer une grille. Par sa forme, par son usage, le bâtiment s’affiche doublement en marge ! Par sa différence avec l’habitait nouveau qui s’installe, issu des processus conventionnels de la maîtrise d’ouvrage, et par le décalage qu’il présente avec l’habitat ancien, support, dans ce quartier, de formes d’appropriation spontanées plus ou moins misérables.
Un soir, un habitant du Buisson Saint-Louis surprend un drogué en train de se “piquer” sous le porche : “Je viens ici tous les soirs, dit-il, cette maison-là me fait rêver...” Alors, faut-il fermer la porte ? Le paradoxe est difficile à vivre. La théorie et le quotidien ne sont-ils pas incompatibles ? L’itinéraire urbain est fermé, sans doute. Sauf pour la vue, pour le regard, pour l’espace. “Forme non figée qui n’interdit rien, précise Bernard Kohn, forme porteuse du possible, de la mémoire de la ville et de son avenir...”
De manière plus générale, l’ouverture sur le quartier relève de la programmation, du maintien des activités dans le tissu urbain parisien. Au programme initial étaient envisagés des ateliers et un cabinet médical. Hormis le cabinet d’un psychiatre, ces éléments ont disparu pour faire place à l’habitat exclusivement. Le seul équipement collectif, non négligeable, est le LCR (Local Commun Résidentiel) vaste, ensoleillé, où se tiennent les réunions de groupe, les activités communes, les jeux des enfants.
Gérer des dires et des désirs
Dès l’acquisition du lavoir en 1979, deux questions se posent aux futurs occupants. Celle de la maîtrise d’ouvrage (le coût, les décisions...) et celle de la cohabitation (le partage de l’espace, de la lumière, sa formalisation, l’aménagement des logements...). En deux mots, il est à la fois question d’argent et d’architecture. Certains évoquent à ce propos de longues réunions de “moi je”. L’un, résumant son appartement disait que, de sa baignoire, il voulait voir sa cheminée ; l’autre ne parlait que des portes, d’autres hésitaient sur la salle commune. Rêver la structure, rêver son volume, rêver son mode de vie et son voisinage, attendre de “l’architecte-artiste” la traduction graphique de ces rêves en dessin, attendre de “l’architecte-accoucheur” qu’il résolve les contradictions et les conflits, et de “l’architecte-bâtisseur” qu’il construise l’ensemble, il arrivait parfois que la “participation” ait un arrière-goût d’exigence et de frustration. Une sorte d’interrogation quasi-passionnelle : A qui appartient le projet ? L’architecte entend-il ? ou au contraire : A trop écouter, sa fonction n’est-elle pas réduite, sans la nécessaire reconnaissance de son autonomie de pensée et d’action ?
“Au Buisson Saint-Louis, rapporte Dominique Tessier, qui était alors collaborateur de Bernard Kohn, qui a suivi le projet et le chantier, usagers et maître d’ouvrage sont une seule et même entité constituant une impossibilité logique, ou une absurdité. Parlant à la fois du point de vue de l’usager pour la qualité des prestations et du point de vue du maître d’ouvrage pour le maintien du prix sans rapport avec les prestations, le groupe s’est engagé dans l’incohérence, et nous l’avons difficilement maîtrisé”. Dans cet ensemble, formé de conflits multiples et d’un désir commun, le rôle du maître d’oeuvre tend à “convaincre qu’un choix en vaut un autre, à concilier les désirs, les velléités, les accords, les jalousies, les surenchères, les ordres...”
Des tendances, bien sûr, mais une constante, une évidence, une maîtrise : la priorité du bâtiment, celle de sa structure et de son existence urbaine qu’il importe de conserver ; pour raisons philosophiques d’urbanité, sans doute, mais aussi pour causes réglementaires, la réhabilitation du bâtiment permettant de conserver le COS et la densité, ce qui rendait difficile tout projet neuf.
De mai 1979 à novembre 1980, Bernard Kohn, selon ses propres calculs, organise 95 réunions de programmation avec les uns et les autres. Progressivement, le groupe se “professionnalise”, les assemblées générales font place à des “commissions” techniques, financières ou architecturales.
Le jeu des échelles
Pour résoudre les contradictions ou les intégrer, pour répondre à des exigences d’autant plus prégnantes qu’elles relèvent de compétences et d’expressions précises, il semble que Bernard Kohn ait su mettre en avant une décision d’architecture forte à l’échelle de la ville et du bâtiment des “grands ordres” qui n’ont guère varié malgré les poussées diverses : “Maintenir une grande échelle urbaine à l’intérieur de laquelle se regroupent les échelles plus petites des désirs de chacun...”
L’échelle urbaine réfère aux emprises en cœur d’îlot caractéristiques du quartier, tel le “Java”, vaste structure en béton armé du début du siècle, aujourd’hui mi-marché, mi-salle de danse, ou la “cour de Bretagne”, espace en creux, structuré par des implantations artisanales.
Sur chaque dessin de Bernard Kohn se retrouve l’éclatement pointillé d’un petit soleil : l’échelle essentielle est celle de la lumière “qui situe l’habiter hors de la petite boîte du logement”. Il instaure comme mode de composition le jeu du fermé/ouvert, le traduit en percements, circulations, escaliers, paliers, espaces de liaison...Le dialogue avec les habitants, les négociations sur le logement, enrichissent et complexifient ce réseau. Bernard Kohn se refuse à identifier la lumière à la fenêtre, l’éclairant à l’ouvrant. Il refuse cette relation élémentaire porte-
fenêtre-mur. “Ce bâtiment est truffé, dit-il, de refus de cette simplification, il interpelle, il dérange peut-être...” Jamais le mur ne se résout à n’être que la stricte limite entre l’intérieur et l’extérieur. Ainsi les éléments vitrés, transparents qui constituent les deux tiers de la peau du bâtiment ne sont-ils pas seulement des fenêtres : parois de verre, impostes horizontales, fentes verticales, éclairages zénithaux composent à l’intérieur un espace lumineux, dynamique, diagonal, profond, insoupçonné de l’extérieur, où les matériaux, au contraire, accentuent le rugueux, l’opaque - bois, brique et béton. Mais non exclusivement, car ils se retournent de même vers l’intérieur : charpente apparente avec des assemblages rudes, parpaings, béton et brique constituent un “tissage”, une superposition des moments de la construction.
De l’intérieur, chaque logement se lit comme une “maison”, reflétant les préoccupations d’usage de ses habitants, avec accès privatif, seuil, terrasse, volume complexe (duplex ou triplex), escaliers. A l’extérieur, passé le porche, le bâtiment se lit dans la totalité d’une “vision existentielle”. Cette dialectique constante entre l’ensemble et le détail, entre la décision du “parti” et les vouloirs des participants est concrétisée au niveau du plan et de la coupe : “Nous travaillons en coupe, en diagonale, la façade n’est pas composée à plat, sauf, peut-être, pour les éléments d’échelle urbaine”. D’où la fluidité de la composition, la perméabilité à la lumière, la diversité des volumes internes et leur savante imbrication les uns dans les autres : tous points qui ont dans une large mesure échappé aux habitants dans la phase d’étude, malgré les croquis et les maquettes, et leur sont mieux apparus une fois le chantier commencé. Ce fait souligne la difficulté de communiquer un projet en volume. Il rappelle aussi que le projet peut se continuer sur le chantier. Bernard Kohn a délégué en grande partie cette phase à l’un de ses collaborateurs. “L’objectif ? Aboutir, sans détournement, répondre aux désirs des futurs habitants, mettre au point les détails de mise en œuvre, effectuer des choix techniques ou relationnels...Ici, les mots comme la forme, portent des sens multiples. Être acteur principal sur le terrain demande une interprétation permanente qui se doit d’être cohérente”. Sur le chantier, le dialogue initial habitant-architecte est devenu relation triangulaire maître d’oeuvre-entreprises-usagers.
Artisanalement industriel
Panneaux modulaires, trame, catalogue d’huisseries, la reconversion du Lavoir du Buisson Saint-Louis tient un discours constructif -et symbolique- industriel. Discours ambigu, si l’on y réfléchit. La structure de bois ancienne définit une trame de 3,10 m ; mais à peu près seulement... Pour Bernard Kohn, l’utilisation d’éléments de série industrielle - ou du moins celle du vocabulaire dont ils sont porteurs - a semblé la réponse à l’esprit du lieu, et surtout le fondement de l’unité de l’ensemble, par rapport à la multiplicité des désirs des habitants : “Une unité, un canevas, le tissage possible entre des éléments, dans lequel chaque spécificité trouve sa voie”. L’analyse du bâtiment relèverait, en somme, d’une manière de “défibrage” du construit, où chaque matériau, chaque série constructive tiendrait le rôle d’un fil dans un tissu complexe, “bois, parpaings, panneaux, verre jouent l’identité et la continuité, s’épaulent, s’interpénètrent en un discours amoureux... J’aimerais bien qu’un bâtiment dise tout cela” explique Bernard Kohn.
Techniquement, l’utilisation d’éléments modulaires - panneaux extérieurs, portes et fenêtres surtout - a posé quelques problèmes. La structure de bois joue toujours un rôle essentiel dans la cohérence construite du bâtiment. Elle a été conservée, consolidée, refaite par endroits. Ses fondations dans le sous-sol instable et humide ont été entièrement reprises. Un chantier difficile, du fait de cette cohabitation entre la restauration d’une charpente ancienne, et la construction, sur ce réseau même, d’une idée résolument moderne. La première entreprise générale qui a abandonné le chantier après un dépôt de bilan, a été relayée par des corps de métier séparés. Aujourd’hui, selon l’opinion de l’entreprise de menuiserie extérieure qui achève les travaux, l’imprécision artisanale des dimensions de la charpente et la complexité des volumes et des percements paraissent difficilement compatibles avec l’utilisation d’éléments de grande série. Sans remettre en question la compétence de l’architecte, elle remet en question ce choix, dont les conditions de mise en œuvre réclament de l’entreprise un savoir-faire spécifique, exclusivement artisanal, afin de répondre “à la fausse trame, aux faux aplombs, à l’absence de tolérance”.
Il demeure difficile d’évaluer précisément le coût de ce bâtiment. On avance le prix de 8 500 F le mètre carré T.T.C. pour le logement. C’est oublier que chaque logement, outre sa superficie privative, dispose d’un local commun, de larges espaces de communication collectifs, de terrasses, et plus spécifiquement d’un volume habitable très important, c’est oublier encore que les habitants participent physiquement à la construction de la rue intérieure, à son dallage, aux finitions des parties communes.
“Nous sommes contents d’habiter ici, presque fiers d’avoir réussi, nous sommes sans doute mieux que nulle part ailleurs...” Il arrive aussi aux habitants du Buisson Saint-Louis de s’interroger sur l’opération : “Nous avons beaucoup parlé, peut-être nous sommes-nous tout dit...Dans ce bâtiment aux allures conviviales, nous vivons chacun chez soi...Nous avons une maison telle que nous la souhaitions...Nous avons conscience d’être une bourgeoisie marginale, matériellement privilégiée...Le quartier est dur, il change, nous avons changé...” Ces bribes, recueillies auprès des habitants du Buisson Saint-Louis questionnent sur la participation. Le bâtiment, comme d’autres rencontrés au fond des passages, à Bastille, Reuilly ou République, démontre qu’il existe à Paris - et à une échelle significative - une architecture du dedans-la-ville, des modes d’appropriation de l’espace urbain, des pratiques et des processus architecturaux capables de déjouer les fatalités réglementaires et formelles de la rénovation.
Pierre Mazzolini, ingénieur et habitant du BSL :
“Nous constituions un petit groupe d’animateurs (14 familles) qui avaient en commun du temps, une stabilité de l’emploi, un certain patrimoine familial (un capital de départ ), une culture en rupture avec le béton, le désir d’habiter la ville autrement, avec une vie de quartier, de la mixité sociale, etc. Nous étions tous persuadés que l’on crée de la valeur en discutant en groupe, convaincus par l’idée d’oeuvre collective et nous partagions aussi des compétences, une certaine formation au droit, aux procédures, un certain nombre de valeurs idéologiques, esthétiques. Mais ce n’était pas la communauté style 68. C’était très familial, un vrai projet d’autonomie familiale.
En tant qu’ingénieur des Ponts et Chaussées, j’avais travaillé pas mal dans l’urbanisme, les constructions scolaires, la rénovation. J’étais le plus âgé. On m’a demandé de présider la CSCP, la Société Civile que l’on a créée, après une phase très informelle. Jean-Louis Gauthier, fonctionnaire à la Jeunesse et aux Sports, était vaguement trésorier. Cette CSCP était la traduction juridique des Castors (qui, à la Libération, auto-construisaient leurs maisons individuelles). On est donc des Castors.
Kohn était très mordu par le projet, il était le seul à nous soutenir. Le notaire était moins convaincu, il trouvait notre idée farfelue. Il y avait des risques : chacun était responsable des autres vis à vis des tiers. Si, par exemple, l’un des membres passe un marché avec une entreprise, et s’il ne peut pas payer ou s’il décède, les autres sont responsables et doivent prendre le relais, avec la complication supplémentaire des héritiers. Il y a eu des conflits, bien sûr. Mais il y avait du répondant, une assise culturelle, des compétences. Nous n’étions pas une bande de doux rêveurs.
Il a fallu un an pour se mettre d’accord sur tous les logements, les modules à assembler. Ils sont tous différents. Cela donne une impression d’unité extérieurement, mais c’est un vrai labyrinthe intérieurement. Celui de Dominique Remy est particulièrement tordu, avec une rotonde à mi-étage...
J’ai du obtenir de mes amis qu’ils admettent le fait que discuter pendant un an avec un architecte, cela coûte de l’argent. Bernard demandait 100.000 F à chacun. Il y a eu un débat à ce sujet : “il nous coûte cher, on croyait que c’était un copain”, etc. On a appris sur le tas. On a du choisir une entreprise. La construction assez complexe faisait appel à tous les corps de métier. On a signé le permis de construire en 80. Le chantier a duré trois ans. Un hiver, l’entreprise est tombée en faillite. Il a fallu tout bâcher. Surréaliste. Il y a une photo qui en témoigne.
Entre l’idée de départ et le résultat final, il y a peu de différence. Seule la ruelle a été abandonnée. On est tombé d’accord sur les matériaux : bois, verre, parpaings, métal, fibrociment (aujourd’hui interdit car il contient de l’amiante). Il y a eu un grand débat sur les façades : un tiers plein, un tiers vitré, un tiers mobile.
20 ans après, la construction qui paraît légère, innovante, a bien résisté. La toiture (papier épais bitumé) a tenu. On a capoté en aluminium la façade la plus exposée à la pluie. On a traité deux fois les boiseries. L’entretien est assez coûteux.
Au départ, on s’autogérait totalement, avec le concours d’un ingénieur informaticien de chez Dassault qui tenait la comptabilité de manière très précise. La tâche la plus pénible était de collecter les versements de chacun. On a constitué une banque interne. Mais au bout de quatre ou cinq ans, jouer le rôle de contrôleur était pénible. C’était toujours les mêmes qui n’arrivaient pas à payer. On a pris la décision de se transformer en copropriété avec syndic, sans gardien. On sort nos poubelles. On lave les parties communes à tour de rôle. Il y a un règlement intérieur informel. On n’a jamais réussi à en écrire un. Il y a des parties communes ( une salle de loisirs, une laverie gérée par une association particulière). La gestion des espaces communs (les vélos, le bois, les plantes) se fait sans interdit.
En face, il y a 300 HLM avec une majorité de familles africaines. Les chinois descendent de Belleville par la rue du Buisson, et une association d’alphabétisation et d’insertion, qui sert de boîte aux lettres à plusieurs milliers de jeunes chinois nouvellement débarqués, s’est installée juste à côté. Il y a aussi l’hôtel et le foyer Emmaüs. Et, un peu plus bas, l’envers du décor : la Cour des Bretons, nouvellement réhabilitée, cossue, avec cour pavée, privée, et sécurisée. C’est le signe que le quartier bouge. Il s’embourgeoise. Il est en train de nous rattraper.
Je me suis trouvé en accord avec les options de Bernard, parce qu’avant de le rencontrer, dans les années 70, en tant qu’ingénieur des Ponts et militant associatif, j’ai travaillé à Roubaix à la réhabilitation des courées, de certains lieux de travail et usines désaffectés. Ma théorie, c’est que la valeur naît de la contradiction ( projet, contre-projet ), qu’il ne faut pas laisser les élus et les techniciens décider seuls du bien des gens. On a ainsi réintroduit une architecture soucieuse de l’environnement, de l’insertion sociale, contre le modèle architectural des HLM. J’étais très attaché au processus de programmation des choses. Il fallait dépenser du temps et de l’argent à concevoir le projet avant de le réaliser, avec le concours des habitants, et non pas apporter des produits clés en main. Il fallait restaurer le débat contradictoire entre le maître d’ouvrage, l’architecte et l’entreprise. J’avais en arrivant ici cette expérience d’architecture participative, de l’autogestion si mal vue par les institutions. Dans tout le quartier, grâce à l’action de l’association “La Bellevilleuse”, il y a eu l’émergence d’une autre façon de concevoir la ville et de l’habiter. Un urbanisme sorti de ses rigidités institutionnelles, de son langage technique, une architecture à visage humain. C’est en même temps très difficile de vouloir contenter tout le monde, avec des désirs contradictoires, des manières différentes d’appréhender le temps et l’espace.
Et pour en revenir à Bernard, on sent qu’il a traversé des mondes très différents, il est ouvert à toutes les idées, les techniques, les cultures. Il y a chez lui un côté bricoleur, assembleur, récupérateur de formes. Bernard est proche du luthier, de celui qui fabrique les violons. Il dessine plus facilement qu’il ne parle. Il n’aime pas théoriser. Il est dans le faire. Il a une perception tactile de chat pour explorer et faire vivre un espace.
Il a été à la charnière du renouveau architectural des années 80, au moment de l’Ambassade de Mexico. C’est un explorateur d’espace, un homme toujours en recherche, tourmenté par son passé, avec sa valise à côté de lui, toujours prêt à partir.”
Annexe
A propos de l’architecture participative
entretien avec un architecte de Grenoble, mai 1986
BK : Je ne suis pas un produit français, tu vois, même le langage que tu utilises, ce n’est pas du tout mon langage. Est-ce que cela veut dire que je n’ai pas de réflexion sur le fondement de l’architecture ? Je dis les choses autrement. Pour moi, les programmes des maîtres d’ouvrage sont mauvais, purement quantitatifs, incomplets.
En arrivant en France en 1969, j’ai été surpris que dans les Écoles d’architecture on ne fasse que du logement. Avant on faisait des palais, maintenant on fait du logement. On va du prince au peuple, c’est peut-être normal, mais moi ce qui m’intéresse, c’est tout le tissu urbain. L’habitat, cela part d’une vision globale, ce n’est pas uniquement le logement. Je suis arrivé ici avec une autre optique, que je n’appelais d’ailleurs pas “participation”, pour moi c’était tout simplement faire son métier.
En 1967-68 en Inde, quand je me suis rendu compte que l’Ecole d’architecture et d’urbanisme où j’enseignais depuis quelques années prenait un côté élitiste, j’ai commencé un travail d’été où on allait dans les villages, pour affiner le regard et la pensée des étudiants. Le problème, c’est que les enseignants se prennent trop au sérieux, et que les gens qui écrivent les programmes ne vont généralement pas voir sur le terrain. Si on veut, comme tu le dis toi, ancrer notre arbre, enraciner notre bâtiment dans un terroir réel, eh bien il faut que l’information que l’on possède soit de première main, donc provienne des gens eux-mêmes, qu’ils soient ou non habitants.
Alors, dans un projet en participation, quels objectifs, quel but te donnes-tu ? Qu’est-ce que l’architecte apporte dans le projet ? Est-ce que les gens pourraient se passer d’architecte ? Est-ce qu’ils produiraient de l’architecture en se passant d’architecte, ou est-ce qu’il y a un “plus” ?
BK : Ah oui, sans hésitation, sauf que le “plus” n’est pas toujours évident. Tu regardes les villes nouvelles, ce n’est pas brillant, même sans participation. Aujourd’hui, on est assez mal barré d’une manière générale. J’ai fait des logements immondes à Cergy, à côté de moi, il y a d’autres logements immondes. Il y en a qui sont pas mal, il y en a qui sont très bien, c’est une cacophonie incroyable. Les gens de la ville nouvelle n’ont pas fait leur boulot. Il n’y a rien qui lie les projets ensemble, il n’y a ni cohérence volontaire, ni incohérence volontaire. Alors, qu’est-ce qu’apporterait la participation dans tout ça ? J’ai tendance à être assez formel, alors ça m’apporterait une raison d’être moins formel, et pas simplement d’avoir à ajouter des petits toits un peu partout comme on le fait. Ça c’est au niveau du détail. Mais à plus grande échelle, ce serait de toucher plus juste au niveau de l’îlot, du quartier, des “entre-deux”, de trouver quelque chose de plus fin qui répondrait en même temps à ce que les gens sentent inconsciemment et à ce que je perçois qu’ils pensent inconsciemment. Ça, c’est le conjoncturel, et puis après, il faut le rattacher à la volonté de faire, parce que c’est un équilibre à trouver entre les deux, le conjoncturel et ce que nous essayons tous de faire, qui s’appelle l’architecture.
Donc la prestation serait plus une interprétation que la réponse à des demandes ?
BK : C’est un peu les deux. C’est presque pour légitimer parfois des options, des différences que le maître d’ouvrage n’accepterait pas.
Justement, est-ce que la participation ne te permet pas d’avoir des arguments pour requestionner le maître d’ouvrage, compte-tenu de ce que tu disais sur les programmes ?
BK : Bien sûr. Je ne sais pas faire des espaces très différenciés, dans le style de Renaudie qui peut imaginer 68 possibilités de se loger dans un même immeuble. Je n’ai pas cette liberté volumétrique. Je ne sais pas faire cette architecture arborescente, et comme j’ai un vocabulaire beaucoup plus figé, j’arrive un peu à ça d’une autre manière, qui tisse les intervenants, les gens et mon optique. Je pars de plans plus rythmés, plus séquentiels, et après j’essaie de complexifier. La complexité vient se greffer dessus. C’est une autre démarche que celle où tout est automatiquement rythmé. Je viens d’une école traditionnelle où on plante une arbre tous les cinq mètres et quand on a un hectare d’arbres plantés tous les cinq mètres, on vient faire une clairière, on épaissit par ici, on fait un genre de mail par là parce qu’on découvre qu’il y a une vue, tout doucement on élague, et cet élagage se fait à partir de quelque chose qui au départ est neutre.
.
Quand tu pars sur une opération en participation, tu te sers d’une trame constructive ? Tu raisonnes ainsi dès les premiers croquis ?
BK : Je cherche des systèmes qui ont une structure très simple, des poteaux-poutres tous les 4,5, 6 mètres, comme avec les plantations d’arbres... Je cherche un type de bâtiment qui sert de base, sur lequel on vient greffer un tas de choses, comme au Buisson-Saint-Louis où l’on est parti d’une trame de 3 mètres.
Finalement, tu fais assez peu de différence entre une opération classique et une opération en participation. Ce qui est toujours le pivot, c’est ta propre manière d’exercer.
BK : Je ferais peu ou pas de différence si le client était impliqué, parce que, finalement, quand on prend le crayon, on essaie d’imaginer tous les cas de figure. J’ai même poussé les futurs habitants du Buisson-Saint-Louis à aller plus loin qu’ils ne l’avaient eux-mêmes pensé : que se passe-t-il quand la fille amène un ami, quand un couple se dispute et que chacun veut avoir son lit pendant plusieurs jours, etc. J’ai même été surpris qu’ils aient une vision aussi figée de leur vie dans un espace donné, qu’ils ne pensent pas que les enfants vont grandir par exemple.
Donc, si je résume bien ta pensée, cette ouverture vers l’habitant ne serait pas d’adhérer formellement à ses désirs ( comme s’ils étaient porteurs de forme), mais plutôt de recueillir un certain nombre de données qui te permettent de dire “finalement l’enveloppe où il sera le plus à l’aise ce sera celle-là” sans aller plus loin. Cela requiert de ta part un travail d’interprétation.
BK : Oui, on peut dire ça.
Est-ce que tu attends de l’habitant un descriptif de ses pratiques pour que tu puisses proposer des formes et en discuter, ou est-ce que tu attends des désirs formels du genre “moi j’aime les duplex” ?
BK : C’est un peu les deux. J’ai travaillé en Inde où j’ai réalisé pas mal de maisons individuelles. Finalement c’est la même chose : tu parles avec la mère, le père, les enfants, tu essaies de voir comment ils vivent, quels matériaux, quel type d’espace ils aiment, tu touilles un peu tout ça en espérant répondre de manière relativement juste à ce qu’ils attendent, mais sans répondre trop juste, pour laisser un peu de marge aux aléas de la vie. Quand tu sais qu’il va falloir trois ans pour construire, qu’ils vont évolué pendant ce temps... Enfin c’est un peu notre métier, ce rôle de balancier, vous avez dit ça, mais attention il y a ça qui risque de se passer, un peu de lucidité, il faut les mettre en garde, il ne faut pas seulement répondre à la folie du moment. C’est ça la programmation.
Et c’est peut-être parce que je ne suis pas un architecte inspiré, comme Kahn, Corbu, Renaudie que j’essaie de trouver les incitations extérieures les plus justes. Je puise l’inspiration chez les gens pour qui je construis plutôt que chez les confrères, dans les revues d’archi.
L’architecte est capable de répondre à une demande, non pas en l’exhaussant, mais en allant plus loin, en l’interprétant avec son savoir-faire d’architecte. Et finalement, il y a bien une rencontre entre tes exigences et celles des habitants.
BK : Oui, mais elle se tisse tout au long du projet. Et en réalité je ne vois pas la différence avec un client pour qui tu construis une maison individuelle, surtout en Inde, où je n’avais aucune idée sur la manière dont les gens vivent. Ils mangent avec les mains. Ils ont une pièce où ils dorment, il y a un grand lit, ce n’est peut-être pas un lit d’ailleurs, il y a une autre pièce avec des meubles occidentaux. Mais ça ils ne te le racontent pas. Alors, si tu ne vas pas voir... Pour moi, la participation, c’est un peu la même chose, si tu ne vas pas voir. J’ai un rêve que je n’ai jamais réalisé, celui de prendre un immeuble de 15 logements identiques, et d’aller voir avec des étudiants comment les gens y vivent et y impriment leurs différences culturelles. A l’Université, sauf exception, on est tous issus du même milieu social, économique et on construit pour des gens qu’on ne connaît pas. Il faut donc aller voir. Je ne suis pas fils d’ouvrier, je ne suis pas ouvrier, et pourtant on a construit des HLM pour des familles de condition modeste. La participation dans un projet locatif, comme à Yzeure par exemple, crée une dynamique, mais il y a une telle mobilité des habitants pendant les 3 ans que dure le déroulement du projet, que la plupart des gens vont occuper des logements que quelqu’un d’autre a conçu pour eux.
Tu dis que dans 15 logements identiques, il peut y avoir 15 modes de vie différents. Donc le lien entre architecture et mode de vie, s’il n’est pas inexistant, est ténu.
BK : Dans les deux projets que nous avons réalisé, j’ai eu un apport conceptuel fort. Au Buisson Saint-Louis, il y a un grand axe qui coupe le bâtiment en deux. C’est moi qui l’ai voulu, mais je ne pense pas l’avoir imposé. Par ailleurs, j’ai eu un rôle de contrepoids dans la composition des groupes de travail, je me suis fait souvent l’avocat du diable, je n’ai pas exécuté simplement ce qu’ils me disaient. Entre le bâtiment des familles avec enfants et celui des célibataires ou sans enfants, j’ai fait un pont, j’ai essayé de combattre la ségrégation. J’ai aidé les groupes à aller au delà de leur réflexion du moment, à se projeter dans le futur.
Est-ce que le fait d’avoir fait de la participation te met dans une posture différente ? Qu’est-ce que cela t’a appris ?
BK : C’est un peu ce que je te disais tout à l’heure. Je suis enseignant, je baigne dans un milieu social tellement identique au mien que cela m’a fait voir autre chose, m’a apporté plus de lucidité et de connaissance des autres. Mais la page blanche reste la page blanche. Je suis toujours aussi angoissé qu’avant : comment commencer un projet, comment l’aborder ? Ce qui m’importe c’est de toucher juste.
En France, les gens aiment les petits toits. Cela leur donne l’illusion de vivre dans des maisons individuelles. C’est ce que l’on a fait à Auch, en réhabilitant des bâtiments R+4. Moi ça me gêne un peu, ce n’est pas ma culture. Au Mexique où je vais souvent, je suis surpris par ce pays aussi vieux que le notre mais très contemporain dans son architecture. Alors qu’ici, les cadres n’ont qu’une envie, c’est de se mettre dans des maisons “île de France”.
Dans ce que tu viens de dire, c’est vrai que l’on est très démuni par rapport au maître d’ouvrage. C’est toujours difficile de s’opposer à un maître d’ouvrage et le fait de s’appuyer sur la légitimité que donnent les habitants est importante.
BK : J’en suis convaincu.
Mais j’ai beaucoup de mal à cerner ce que tu en fais parce que tu n’as pas l’air de prendre la participation comme un cas spécifique. Il y a toujours, quelles que soient les opérations, ta signature.
BK : Mon idéal, ce sont ces grandes forêts où il y a de beaux grands arbres avec la vie qui grouille tout autour. Je reviens souvent à cette image. Mes projets sont bourrés de choses que je décide. Au Buisson Saint-Louis, en dehors du chemin central, il y a ces éléments de grande hauteur, ce porche et ces colonnes devant. A Yzeure, c’est bourré de petites poutres, dans tous les sens, à bonne hauteur, que les gens s’approprient, personnalisent. Ils n’en voulaient pas. Je leur ai montré que ça pouvait être très chouette. La participation, c’est cet enjeu d’offrir et de convaincre, et ça compte d’avoir un groupe de gens prêts à se bagarrer. Cela se voit sur les photos, j’ai des projets qui ne sont peut-être pas sublimes, mais j’ai l’impression que les gens y vivent mieux qu’ailleurs. A Yzeure, les gens se sont connus, ont travaillé dessus, ont imaginé. 35 logements où les gens se connaissent... rien que ça.
C’est sans doute important, mais en prenant un peu de recul, c’est une justification sociale de la participation. L’architecte, lui, ne peut s’en satisfaire quant au projet lui-même. Il bâtit pour la durée. Il faut bien qu’il prenne une distance par rapport à tout ce qui a été exprimé de conjoncturel et de local. Où va-t-il puiser ses référents ?
BK : Là où il a l’habitude, partiellement dans les bouquins de sa bibliothèque, partiellement dans ce qu’il y a en lui, modifié par le regard sur sa propre démarche. La participation aide un peu mais tout reste à faire.
Y-a-t-il une pédagogie de l’espace avec les habitants ? L’espace est-il un enjeu dans l’architecture participative ? Pour l’architecte, l’espace est une catégorie de la pensée, de la réflexion. Mais pour l’habitant, “l’espace du salon” peut se réduire à la petite vitrine dans laquelle il a mis un certain nombre d’objets qui résument quelques épisodes de l’histoire familiale : le petit buste de Voltaire n’est pas là pour dire l’écrivain, le penseur que souvent il ignore, mais parce que le fils est allé au lycée Voltaire. C’est plus un objet support, trace, mémoire d’un événement que l’indice d’une culture partagée. Tous ces petits objets qui constituent le bazar du kitsch sont en fait des évocations avec une petite valeur d’exposition. Alors, pour pousser la caricature, faire parler ces gens sur les qualités spatiales de leur séjour... Je pense aussi à cet architecte grenoblois qui a fait du PLR et pensait bien faire en voulant mettre les arabes au dernier niveau, sous les toits. Il s’est rendu compte qu’ils ne voulaient pas y aller. Ce qui est ressenti par les uns comme effet d’espace, volumes sympas sous les toits, est perçu par d’autres comme une relégation “on nous fout dans les greniers, et pourquoi pas à la cave carrément “. Et si certains habitants s’en foutaient de ce discours sur l’espace, le spécifique, l’original ? Ils ne veulent pas être hors norme, à l’écart, bien au contraire, ils veulent être comme tout le monde, comme les enfants qui ne veulent pas se différencier des autres enfants en matière d’habits, etc. C’est une pulsion très forte et c’est aussi parfois un mode d’ascension sociale. Alors si tu arrives avec une certaine idéologie dans la participation, tu fais exploser tout ça, tu es celui qui sait, je te garantis qu’en face ou ça fiche le camp, ou alors il faut être borné, culotté pour tenir le choc, ou c’est la panique et en avant la pédagogie.
Il ne s’agit pas de critiquer les uns ou les autres, mais il y a des passerelles qui sont valables pour certaines catégories d’habitants et il y en a d’autres pour lesquels ce n’est pas dans cette direction que la réponse est bonne.
Comment, à un moment donné - tu disais “toucher juste” - “interpréter juste” ce que tu penses avoir capté de tes interlocuteurs ? Les archétypes, visiblement, ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Ce que je trouve intéressant, c’est la chute des grands canons esthétiques où l’on passe de l’homme universel à la participation et à l’homme particulier. Il devrait y avoir alors différents modes de réponse, c’est cela que j’appelle la prestation architecturale. L’architecture dans la participation, je la situe là.
BK : Sauf que moi, j’aimerais pouvoir tenir les deux, le particulier et l’universel. Ils sont aussi importants l’un que l’autre. Je suis d’accord avec ce que tu dis sur les différentes réactions et les différentes réponses à apporter. Dans les religions tu trouves ça aussi, venant de gens d’horizons différents. Entre les juifs venant de l’Est de l’Europe et ceux d’Afrique du Nord, tu as ça aussi.
Les Ashkénazes et les Séfarades ?
BK : Oui, par contre il y a un fonds commun. Moi, je ne tranche pas, je dis que les deux existent. Je situerais l’architecture là, dans les deux camps, dans l’un, dans l’autre, et dans les deux, dans trois choses en fait.
La maison d'enfance de Bernard Kohn
Architecte : Charles Siclis
6. Retour aux sources, inspirations, origines, influences, références...
- La maison de Nogent
- Les gens qui ont compté : Patrick Geddes, Louis I Kahn, les personnalités en sciences sociales, économiques et humaines.
- Les années USA
- Le périple indien
- Le retour en France
-Would you tell me, please which way I ought to go from here ? she asked.
-That depends a good deal on where you want to get to, said the cat.
Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles
La maison de Nogent-sur-Marne,
la maison de l’enfance
C’est la maison où je suis né, avenue de Joinville, une maison très originale, la seule d'une écriture totalement contemporaine dans une rue bordée de pavillons traditionnels en meulière apparente. C’était la seule maison à toit plat de tout Nogent, avec de grandes baies vitrées qui coulissaient verticalement, des murs lisses en enduit clair et une vaste trouée sous la maison qui servait d’entrée. Les voisins l’appelaient “le garage”. Ils avaient même pétitionné pour obliger mes parents à détruire les excroissances qui couvraient le toit et qu’ils surnommaient avec mépris des “champignons”. A l’intérieur, il y avait une très grande salle de séjour à double hauteur avec un escalier qui montait sur deux côtés jusqu’au premier étage et se prolongeait par une coursive qui desservait les chambres. Les angles étaient arrondis, selon le souhait de ma mère qui pensait que c’était plus facile à nettoyer. Mon père, marchand de bois “éclairé”, avait voulu, avec ma mère, faire construire une maison contemporaine. Il s’était adressé à Auguste Perret, qui, trop occupé, lui avait conseillé un autre architecte, Charles Siclis. Quelqu’un d’exceptionnel et de trop méconnu encore à ce jour. Il a construit également un superbe théâtre, avenue de Clichy. Il a émigré à New-York en 1939, où il est malheureusement mort dans l’oubli total, et sans travail.
Cette maison mériterait d’être classée. Elle existe toujours, avec un jardin amputé par l’élargissement de l’avenue. Inutile de dire qu’elle a été ma première “inspiration”. Je retrouve dans mes projets cette fascination pour les courbes, les arrondis, le bois, la lumière... Je me souviens des grandes fenêtres sans volets, des jeux sur la rampe de l’escalier, du poulailler au fond du jardin. J’ai deux frères plus âgés que moi. J’étais le petit dernier. J’ai de bons souvenirs de cette maison-là.
C’est la maison mère en quelque sorte, celle du lien familial, avant la guerre, la fuite, la dispersion. Je ne me rappelle pas parce que j’étais trop jeune, mais même la famille autour de nous n’avait pas senti venir la guerre. Dès 1935, mon père disait : “la prochaine fois, c’est notre tour”, ce qui signifiait “nous, les gens d’origine juive”. A l’école, on m’a traité de “juif” une fois, mais c’était plus tard, en 1939. En 1940, nous avons pris le chemin des USA. Le périple a duré un an, pendant lequel j’ai du faire cinq écoles différentes. Un trajet compliqué, de Granville, au bord de la Manche où nous passions les vacances, à Arcachon, Toulouse, Saint-Tropez, puis Madrid, Lisbonne. Là, nous avons pris un bateau avec ma mère. Nous n’avions pas de droit d’entrée aux USA, parce que nous étions sans visa. Alors il a fallu biaiser par La Havane. Partis de France en septembre 1940, nous sommes arrivés à New-York en décembre 1941, juste après Pearl Harbor. J’avais dix ans.
Bernard Kohn est retourné voir la maison de Nogent, au printemps 2003. Nous y sommes allés ensemble. Il voulait me la “présenter”. Nous avons eu quelque difficulté à nous faire ouvrir le grand portail métallique par les propriétaires actuels. Et puis ce fut le choc. D’emblée me sautent aux yeux la modernité, le toit plat, l’aspect garage, le béton, la hauteur des portes-fenêtres d’un seul tenant, la volonté de s’inscrire dans un autre espace mental que celui des maisons en meulière petites bourgeoises qui longent l’avenue. Dès que nous franchissons le seuil, l’émotion envahit Bernard. Toute son enfance lui remonte aux yeux. Le hall aujourd’hui rempli de mobilier et de bibelots bretons est vaste, la montée d’escalier et la mezzanine somptueuses, les boiseries couvrent une partie des murs et de hautes portes courbes séparent l’entrée du reste du rez-de-chaussée. On visite. On monte jusqu’aux chambres. La maison est grande, lumineuse, labyrinthique, avec des entrées et des niveaux multiples, entourée d’un jardin.
“Cette maison est un acte subversif de mes parents dans ce quartier résidentiel bon chic bon genre” me dira plus tard Bernard. La maison de Nogent est fondatrice, comme un livre ouvert où est inscrit le plus intime de ce que sera sa démarche. J’ai compris quelque chose de Bernard ce jour-là, et j’ai envie de savoir comment il est devenu architecte, quand il a choisi de devenir architecte. Et d’où vient cette aptitude à dessiner, à transcrire en idéogrammes ses idées, ses réflexions ?(en discussion avec Françoise Séloron).
Je ne sais pas, j’ai sans doute dessiné depuis toujours, mais je ne me souviens pas vraiment. A douze, treize ans, j’étais en plein dans la construction de maquettes de voitures et d’avions avec des petits moteurs qui n’ont jamais pu réellement décoller. J’étais un bon élève. J’aurais voulu faire “liberal-arts” ( culture générale) à l’université. Dans les années qui ont juste suivi la guerre, je n’avais pas cet esprit de rebellion des adolescents, je faisais partie d’une génération qui ne pensait pas pouvoir se permettre cette liberté, par rapport à d’autres, presque du même âge, qui avaient combattu. Alors je me suis inscrit à l’Ecole des Industries du Bois, à Syracuse, dans l’Etat de New-York - mon père ayant insisté pour que je fasse une formation dans cette branche, pour suivre le sillon familial -, mais je suivais des cours d’art et de philosophie comme auditeur libre dans d’autres départements. C’est l’avantage d’un campus américain où toutes les disciplines se retrouvent dans un même périmètre restreint.
Après deux ans passés à étudier la technologie du bois, voulant sortir de cette filière pour laquelle je n’avais pas la fibre, j’ai pensé à l’architecture comme le seul moyen d’être à cheval entre un métier et l’art. Je n’ai pas eu de rêve d’architecte mégalo, construire des immeubles de 20 étages, etc. Cela ne me ressemble pas. C’est lié peut-être à une certaine timidité, une certaine pudeur. Je n’aime pas le gigantisme. “Small is beautiful”, livre de E.F. Schumaker « Economics as if People Mattered » ;
Je ne sais pas d’où je tire ce manque d’arrogance.
En tout cas, quand j’y repense, la maison de Nogent-sur-Marne qui est inscrite en moi depuis l’âge de six, sept ans, a certainement été le déclic inconscient qui m’a conduit à l’architecture.
Les hommes qui ont comptés
Ou, l'art de la transmission.
Dans les années cinquante, les USA étaient devenus un des grands foyers de l’architecture contemporaine, nourri en partie par les architectes et les artistes européens qui y avaient émigré (Walter Gropius, Mies Van der Rohe et d’autres du Bauhaus, puis José Luis Sert, etc.), mais aussi par la présence de Frank Lloyd Wright, qui, par un de ces fascinants ricochets de l’histoire, avait dans les années vingt influencé lui-même les débuts de l’architecture contemporaine en Europe. Le Corbusier resté en France était alors à la prou de ce mouvement.
Les personnes, en dehors de ces grandes figures, qui ont influencé Bernard Kohn, qui ont jalonné son parcours sont souvent atypiques. Il les a découverts très tôt, au hasard d’une lecture, en feuilletant un magazine, et il a réagi très vite, pour ceux qui étaient ses contemporains, en leur écrivant, en sollicitant une rencontre, une collaboration, en émettant le désir de travailler avec eux. Ces personnalités, il leur a été fidèle toute sa vie, reprenant une idée, un geste, une manière d’être et de faire qu’il a intégrés. Et puis, il y a toujours eu l’Inde qui a fait irruption, à un moment, comme un effet du destin. Il a toujours partagé ce qu’il avait reçu, et donné à son tour. Bernard Kohn possède l’art de la transmission.
Georges NAKASHIMA
“Quand j’étais à l’école d’architecture à Columbia, en première année, c’était en 1950-51, j’ai lu un article sur Georges Nakashima, un américain d’origine japonaise qui avait abandonné l’architecture pour ouvrir un atelier de conception et de fabrication de meubles. Avant la guerre, il était venu en France puis avait travaillé avec un architecte américain au Japon, Antonin Raymond, qui l’avait envoyé en Inde pour la construction d’un ashram, commande du philosophe indien, Sri Aurobindo. A son arrivée à Pondichéry, en 1937-38, avec les dessins du bâtiment qu’il avait conçu sous le bras, il demande avec quel ingénieur il va travailler. On lui répond que l’ingénieur, c’est lui. C’est à lui de réaliser le projet, de A à Z. Nakashima n’avait pas été formé pour cela. Alors il a fini par admettre l’idée qu’il lui fallait recommencer de zéro : “I had to come back to humble beginnings”.
Puis la guerre arrive. Retourné aux U.S.A., en tant que japonais, il est emprisonné dans un camp en Californie. C’est là qu’il rencontre un menuisier-ébéniste japonais, interné comme lui, et qu’il commence à faire des meubles.
Après la guerre, Antonin Raymond lui prête un terrain en Pennsylvanie, où il vit dans une caravane avec sa femme Marion et son bébé Mira, avant de construire sa maison, puis d’installer un atelier de fabrication de meubles, très inspiré du style de mobilier des “Shakers” et des “Quakers”, colonies religieuses installées dans la région. Il achète de grandes billes de bois qu’il découpe en tranches et fait sécher entre des tasseaux pour en faire des tables, des chaises, etc. Bien longtemps après, ayant lu cet article où l’on décrivait tout son périple, USA-France-Japon-Inde-USA, je lui ai écrit une petite lettre, je suis allé le voir, je lui ai demandé si je pouvais faire un stage chez lui. Il avait un discours très “anti architecte” : “Vous êtes tous arrogants, vous et vos écoles” disait-il. Il revenait toujours à Sri Aurobindo. “Il faut retourner aux sources, à des choses humbles”, ajoutait-il. Tout cela m’a beaucoup influencé. Je suis arrivé l’été suivant avec ma petite valise. J’avais loué une chambre à proximité. Le premier jour, assis à côté de lui, j’ai raboté des tourillons. Je lui ai posé une question. Il m’a répondu trois jours après. Début “hard”. Il y avait aussi un “quaker” très sympathique, pacifiste-écolo-religieux. Je suis revenu chez Nakashima trois étés de suite. C’était un personnage un peu rugueux, à la fois architecte et ébéniste, parlant peu, mais juste. Il reprenait peu à peu des projets d’architecture. Un jour, le voyant arriver avec les plans d’une maison en bois que j’avais dessiné pour lui, et qu’il venait de proposer à des clients, je m’aperçois qu’il les avait complètement modifiés. Et comme je lui fais remarquer qu’il y a beaucoup de changements, il me réplique, sans plaisanter que “c’est seulement de l’évolution”. Je me souviens de ces étés, on travaillait torse nu et Mira, sa fille, qui avait alors douze ans, nous dessinait des choses dans le dos avec un gros crayon de menuisier en cire rouge. C’était vraiment un stage atypique. Le troisième été, avec un ami de l’école on a été embauchés comme main-d'œuvre “spécialisée” par un entrepreneur de la région pour construire, avec son équipe, une maison à ossature en bois, de A à Z . On avait 20-22 ans. Nakashima a été un peu mon gourou de cette période. C’est à lui, puis à Geddès par la suite, que je dois d’être parti en Inde. Nos chemins se sont recroisés plus tard, à Ahmedabad, où il est venu animer un stage au National Institute of Design, une école fondée dans l’esprit du Bauhaus.
Bien entendu, avec Nakashima, je retrouvais le bois du chantier de mon père, mais aussi le désir de travailler avec mes mains, et l’idée qui ne m’a pas quitté jusqu’à ce jour de conjuguer la pensée et le faire, contrairement à l’enseignement des écoles d’architecture qui ne se préoccupaient pas plus à l’époque qu’aujourd’hui, de fabrication.
De Nakashima, je retiens cette "calme" détermination, de persévérer sur un "cap" personnel et singulier: le sien..., d'en limiter les interférences, même si nécessaire de se justifier (rationaliser) sa position des fois excessivement, voire de mauvaise foi.
Aussi le calme en travaillant le bois dans l'atelier. Une concentration. On se donne à la tâche.
Mais cela lui permettait d'avancer et ne pas se laisser dévoyer de son propre cheminement.
J'avais beaucoup apprécié sa ténacité, cette quête de travail bien fait, absence de parlottes, ce fort noyau de soutien familial.
Dans un haut entrepôt, ces grands "plateaux" de toute largeur des arbres, et sur lesquels, ayant une "commande", un projet d'une réalisation, il sélectionnait une planche qui correspondait le mieux à son intention et il dessinait avec une craie directement dessus en adaptant le "projet" à la spécificité de cette planche "là".
Certes il y avait des dessins préliminaires, des exemples déjà réalisés.
Puis, en amenant la planche dans l'atelier même, le travail de "découpe", de fabrication démarrait.
Moi même J'ai toujours pratiqué cette imbrication de conception et de fabrication, tout du moins en ce qui concerne la réalisation de mobilier.
D'une certaine manière, dans l'Inde de 1962-68, on pouvait modifier, sur un chantier de bâtiment, des éléments (bien évidemment dans certaines limites), et cela permettait cette forte continuité entre projet et réalisation.
Les antécédents son multiples. Dans tout le passé bien évidemment, et plus récemment avec l'exemple du Bauhaus d'alliance entre la conception et la fabrication.
Jean Prouvé en est un exemple plus récent. Cette imbrication, véritable poésie de tisser ensemble conception et fabrication effraie ceux qui sont rigides et qui manque d'imagination.
Il sont come mis en cause par cette liberté, et Prouvé en a subit l'amère expérience étant par la suite du rachat de son entreprise, carrément "viré" de ses ateliers et "exporté" vers les quatre murs d'un bureau Parisiens.
En France, on est complètement "ficelé", et de modifier un projet, sur le chantier, et quasiment impossible. On y perd tout un dialogue, une chaleur, une réelle synergie humaine, entre nous qui concevons et vous qui construisez.
Ce qui ne veut pas dire "qu'il faut modifier", mais rapprocher la tête de la main. C'est un débat certainement social et presque politique.
Louis I.KAHN
Après mes études et les deux années passées dans l’armée américaine, je suis tombé par hasard, en feuilletant une revue d’architecture, sur une petite photo qui représentait le détail d’une poutre d’un superbe bâtiment construit à Philadelphie. J’ai eu immédiatement envie de travailler avec l’homme qui avait conçu cette structure, démolie depuis. C’était Louis Kahn. Il n’avait pas de place dans son agence, mais il m’a proposé de m’inscrire à l’Université dans son “master-program”. J’étais donc dans sa classe d'une année. Il avait des expressions très personnelles, très fortes, il fabriquait ses mots : Il faut chercher le sens des choses, “search of meaning”, remonter à la source, retrouver le fondement, la qualité des choses, “l’institution” au sens américain du terme, “to go back to the beginnings of an institution, to its institutionnal will”, revenir à la nature intime, à l’essence, à la volonté primordiale de
ce qui a prévalue l'inspiration qui a engendrée les débuts.
exemple :les débuts de "l'école", de l'espace public: de la rue, "a meeting place", mais aussi "ce que souhaite être une brique," une arche...
‘The city is only a part of the inspiration to meet.’ ‘but if you think of the street as a meeting place, if you think of the street as being really a community inn that just doesn’t have a roof... And the walls of this meeting place called the community room, the street, are just the fronts of the houses...’ , ‘And if you think of a meeting hall, it is just a street with a roof on it.’
Louis Kahn s’exprimait évidemment par le dessin, par ses projets, mais aussi avec le langage, l’écriture, la narration. C’était un formidable conteur. L’ayant raccompagné très tard un soir, il m’a dit tout bas, au pied de son immeuble : “je suis probablement plutôt un enseignant qu’un architecte” - le mot “teacher” en anglais est plus large de sens qu’enseignant et moins lourd que maître -.
Il aimait raconter l’histoire d’un homme, Socrate, sans le nommer, qui sous un arbre, chaque jour au même endroit, parle, discute avec des jeunes qui s’intéressent à ce qu’il a à dire... Ce n’est pas encore le maître et ses disciples, mais des personnes qui aiment se rencontrer. Puis lentement, au fil des jours, ces rencontres s’élargissent à d’autres, qui à leur tour, tout près, attirent d’autres disciples. Il faut construire un lieu, des lieux pour “institutionnaliser” ces rencontres. C’est ainsi que sont nées les écoles. Ce qui fonde les choses pour Kahn, c’est l’étincelle initiale, le premier regard amoureux, la lumière, ce qu’il faudra maintenir, alimenter, faire vivre, se remémorer à chaque étape de la vie de l’institution. Ce qui compte, c’est ce qui précède l’institution, au sens que Kahn donne à ce mot, très éloigné de la définition française.
Cette étincelle, cette première lumière vers laquelle on va, on revient, pour découvrir, redécouvrir le sens, l’humanité d’un projet, il l’appelle la “forme”, qui donne naissance, dans un deuxième temps, à "la mise en forme" ("form and design").
Louis I. Kahn, que les initiés qui travaillaient dans son atelier appelaient “Lou”, (nous, ses élèves, nous n’osions pas, cela remonte pour moi à 1960) était une personne exceptionnelle, un homme comme on en rencontre rarement dans sa vie. Le respect que nous avions tous pour lui tenait plutôt à ce qu’il nous révélait, alors que nous étions déjà tous formés, sauf peut-être à l’essentiel, ce qu’était l’architecture avec un grand “A”, la recherche signifiante d’un monde à déchiffrer, à découvrir, l’élan vers un passé, une mémoire, mais aussi le questionnement du présent et d’un futur à tracer. Et tout cela très loin de cette peur non-dite qu’ont parfois les étudiants par rapport à leur professeur, et qui n’a rien à voir avec l’architecture.
Je me souviens de sa chaleur, de son rire, de sa très réelle présence, sa façon de marcher en sautillant presque, les épaules en avant, je me souviens de son regard vif, pétillant, de sa maîtrise du langage, sa manière de détourner certains mots et d’en inventer d’autres, de sa “quête” pour ne pas dire recherche qui serait trop scientifique.
Tous ces éléments nous attachaient fortement à l’homme, et par là, aux hommes, donc à nous-mêmes. Il y avait cette référence à Socrate, mais aussi aux philosophes d’influence biblique comme Martin Buber, Emmanuel Lévinas, Henri Atlan.
Il y avait dans sa pratique, dans son enseignement une forte dimension éthique totalement inséparable de la dimension architecturale. Cette éthique quasi-militante, mais pas au sens habituel et politisé français, avait une profondeur d’où émanait de façon sous-jacente l’humour, donc la vie, la fin du XXe siècle, la Lituanie, l’immigration aux U.S.A...
Louis Kahn était un théoricien, mais pas dans le sens habituel. Il a été à l’origine d’idées actuelles dans d’autres disciplines que l’architecture, essayant de faire se cotoyer “le cristal et la fumée”, selon l’expression d’Henri Atlan.
Il souhaitait faire surgir des éléments fondateurs qui donneraient une raison existentielle à ses projets, des lignes de force approchées par tâtonnement, beaucoup plus par intuition poétique que par démarche rigoureuse et qui se juxtaposaient de façon illisible pour ensuite évoluer, se déformer, se restructurer, se renforcer. Comme si on plantait une forêt régulière, puis, progressivement, on créait ici une clairière, là on coupait certains arbres, ailleurs on en replantait. L’apparente rigidité de départ prenait ainsi une autre forme, répondant aux exigences du projet lui-même, à son développement face aux incursions et nécessités extérieures, mais sans perdre de sa réalité première.
Le "programme", ce document que l'on vous remet au début d'un projet, selon Kahn était un point de départ quantitatif qu’il fallait comprendre et mettre de côté au plus vite pour le dépasser. Comme un liquide que l’on réduit à l’essence. De cette réalité première, il était nécessaire de s’extraire rapidement vers un domaine spéculatif, qualitatif, un monde de potentialités, d’évidences autres d’où repartir pour aborder à nouveau la réalité. De ces va-et-vient successifs, une cristallisation se créait, elle-même fragile, susceptible d’être déformée, remodelée.
Kahn a eu progressivement une influence énorme sur son entourage, sur la vie architecturale de Philadelphie, puis des U.S.A., influence de rigueur, d’éthique, d’humour, de sincérité, de recherche de sens, mais aussi de doute.
Comme enseignant, contrairement à certaines pratiques françaises, il n’est jamais devenu un mandarin. Il était toujours humain, accessible, fragile, sérieux sans se prendre au sérieux. Même au plus fort de sa carrière, il ne manquait jamais un cours, trois fois quatre heures par semaine. C’est dans son enseignement qu’il était (ou paraissait être ) le plus sûr de lui, le plus clair, le plus méthodique. En réalité, l’enseignement était pour lui l’occasion de s’exprimer librement, de tester des idées qu’il avait certainement des difficultés lui-même à mettre en oeuvre dans son atelier.
Professionnellement, il n’était pas dans une relation de patron à employés, même si cette réalité existait. L’atelier respirait plutôt une ambiance de recherche commune. Les maquettes foisonnaient de partout. Elles étaient les outils vivants de l’évolution des projets, qu’elles soient en terre glaise pour les sites urbains à grande échelle, ou en bois de différentes essences, mais toutes fortement ancrées sur de lourds socles. Ces maquettes n’étaient pas seulement des objets de représentation, elles étaient de véritables sujets de recherche.
Il “vivait” dans son atelier. Evidemment, par rapport aux autres architectes, ses projets étaient parfois en retard, parfois hors propos, et parfois même hors budget. Il espérait toujours que son client, comme inspiré, suivrait, comprendrait. Car pour Louis Kahn, l’architecture peut donner naissance à des bâtiments mais aussi à des comportements.
Il était à l’opposé du “parisianisme”, “new-yorkisme”, “philadelphisme”. Est-ce un exemple à prendre comme tel ? En tout cas il est un repère, une mémoire, un miroir pour la réflexion de chacun d’entre nous.
Louis Kahn est un homme à redécouvrir tout au long de nos carrières. Autrement que Frank Lloyd Wright, l’américain, autrement que Le Corbusier, l’européen. Tous deux avec un regard sur l’engagement et sur le rapport entre l’émergence d’une société et le langage des formes. Louis Kahn a des points communs avec les deux, auxquels il faisait ouvertement référence. Certes, il n’a pas l’inventivité de Frank Lloyd Wright, ni cet étonnant dynamisme à toutes les échelles d’intervention de Le Corbusier.
Mais il est, de mon point de vue, plus universel, moins ouvertement “génial”, plus humainement fragile. Il nous parlera peut-être plus longtemps.
Ce qu'il a été pour moi? Ce qui a le plus compté? Qu'est-ce qui m'a remué?
Patrick GEDDES
Quand j’étais enseignant à Yale, je suis tombé sur un petit livre de Jacqueline Tyrwhitt “Patrick Geddes in India”, qui m’a totalement séduit, qui a été décisif pour moi et dans mon départ en Inde. Geddes est un homme passionnant. Né en 1854 en Ecosse, élevé à la campagne, il se consacre d’abord aux sciences naturelles. A la foi biologiste, sociologue, pédagogue et urbaniste, il a débuté comme jeune chercheur en botanique, travaillant un temps au Mexique. Il étudiait alors au microscope le développement des cellules dans un milieu vivant. Il a du arrêter ses recherches à cause de problèmes de vue. Finalement, ce qui l’intéressait, c’est cette chaîne d’organismes qui flottent, s’assemblent, se multiplient dans des environnements de plus en plus grands et complexes. Le principe des poupées russes, qui reproduit des situations similaires à différentes échelles. Et appliqué au développement urbain, cela donne : la maison, l’ilôt, le quartier, la ville, la région, le pays, le continent, le monde...
Il est l’un des pionniers de l’introduction de l’écologie en économie, il réfléchira toute sa vie aux problèmes de l’éducation, adepte de la pédagogie dite “active” qu’il a appliquée à l’étude de l’environnement dans ses dimensions à la fois physique, biologique et sociale. Il a séjourné et travaillé à Chypre, en Israël où il participe à l’extension de Tel-Aviv, et plus longuement en Inde où il effectuera de nombreuses études urbaines et régionales, sera nommé Directeur du département de sociologie à l’Université de Bombay et nouera des relations amicales avec le poète Rabindranath Tagore.
C’est essentiellement par ses travaux et ses publications sur l’urbanisme qu’il accède à la notoriété. Il est mort en 1932 à Montpellier, où il avait été attiré par le botaniste Charles Flahaut et où il avait créé en pleine garrigue, sur une colline surplombant la ville, “le Collège des Ecossais”, une institution au fonctionnement pluridisciplinaire, entouré d’une succession de jardins retraçant l’histoire de l’humanité : les cavernes troglodytes, l’enclos celtique, le patio romain, le jardin Renaissance, la terrasse du nombre d’or, l’allée des philosophes, le jardin japonnais, l’enclos des muses, etc. ll rêvait d’une université méditerranéenne et militante, ouverte sur la ville. Aujourd’hui l’espace du “Plan des quatre seigneurs” est occupé par le Rectorat et l’Ecole d’architecture, mais les deux lieux sont séparés par un mur.
Avant la première guerre mondiale, il a réalisé une grande exposition pour sensibiliser les gens à l’urbanisme, qui a eu un retentissement international. A la même époque, avec sa femme, à Édimbourg, il a mené une action sociale contre les taudis, pratiquant la “réhabilitation par l’exemple” en allant s’installer avec sa famille dans l’un des quartiers très pauvres de la ville, ouvrant une boutique pour aider les gens à s’informer, s’organiser et défendre leurs droits en matière de santé, de vie quotidienne, de logement, etc. Ce que l’on a appelé après 68, “advocacy planning”, bureau d’aide sociale, permanence de défense des droits, etc. Puis il a lancé d’importantes opérations de rénovation, il est même à l’origine de la première résidence universitaire de la ville.
Une autre idée, matérialisée par un bâtiment, qui m’a marqué et que j’ai reprise par la suite, c’est l’outlook-tower, une sorte d’observatoire des ressources urbaines et humaines, qu’il a conçu à Edimbourg dans une ancienne tour médiévale réhabilitée, et que chaque municipalité devrait posséder : une construction à la fois symbolique et bien réelle de la citoyenneté et des différents pouvoirs, services et espaces publics, une tour pyramidale, avec en haut l’information sur le quartier et au fur et à mesure que l’on descend les étages, une information à une échelle plus large, celle de la ville, puis de la région, etc.
L’outlook-tower est à la fois le centre de ses activités et le symbole de sa démarche. Du sommet, il peut expliquer toute l’organisation d’Edimbourg dans son site géographique. Et les cinq niveaux de la tour, à la fois laboratoire de sociologie et exposition, rendent compte de son approche des sociétés humaines, ordonnée selon la grille d’analyse lieu-travail-population, que Patrick Geddes emprunte au français Frédéric Le Play, une autre de ses ressources intellectuelles majeures . ( Le Carré Bleu, l’actualité de Patrick Geddes, revue internationale d’architecture, 2/93 )
Tout cela fait partie intégrante de mes préoccupations.
Je me suis toujours demandé pourquoi Patrick Geddes est méconnu à Montpellier comme partout en France. En fait, tout ce qui est de l’ordre d’une démarche transversale, d’une pensée globale gêne les structures mentales d’ici où l’on a tendance à tout sectoriser. C’est vrai que l’architecture relève de cette même transversalité. Cette recherche de fil conducteur semble gêner les pouvoirs, donc celui de l’argent aussi.
Il est intéressant de souligner que ces trois personnes qui m’ont le plus influencé, Georges Nakashima, Louis Kahn et Patrick Geddes, ont eu tous les trois un rapport avec l’Inde. Et c’est dans ce même pays, alors qu’il se trouvait de passage à Ahmedabad, que j’ai rencontré Christopher Alexander, mathématicien et architecte remarquable, qui m’a aussi beaucoup marqué, notamment en ce qui concerne ses méthodes de programmation : la notion de “défibrage” qui consiste à décortiquer un projet compliqué en différentes composantes ; l’idée de “pattern”, de modèles incontournables à incorporer à tout projet ; la multi-fonctionnalité des lieux, la nécessité de concevoir par exemple tous les escaliers avec des espaces de repos, des paliers, des fenêtres donnant sur une vue. Ses livres “A pattern language”, “The timeless way of building”, entre autres, sont des références en matière de méthodes de travail en architecture.
J’ai bien sûr été marqué aussi par le Bauhaus et d’une certaine manière par F.L.Wright, pour qui j’ai travaillé comme menuisier dans une équipe d’artisans à la fabrication d’une “prairie house” dans une grande exposition qui précéda, sur le même terrain, le Musée Guggenheim.
Plus tard, j’ai été attiré par Dom Helder Camara, “l’évêque des bidonvilles”, avocat des pauvres et apôtre de la “théologie de la libération” et de la non-violence au Brésil, qui prêchait le retour aux sources du christianisme, qui militait en aidant les plus démunis et en faisant de l’alphabétisation dans les favellas. J’ai lu aussi “La pédagogie des opprimés” de Paolo Freire. Leur discours, leur message et leur travail consistaient à dire aux gens des favellas : “Pour vous défendre, il ne faut pas parler le langage des riches qui l’ont eux-mêmes emprunté aux Européens, il faut utiliser votre langage, les mots qui sortent de vos tripes”.
J’ai aussi vécu avec des psychanalystes et une femme indienne qui abordait l’art comme un des moyens pour les plus pauvres d’exprimer leurs désirs et leurs angoisses. En fait, je suis attiré par la pédagogie et la psychologie, par l’idée d’aller vers les gens et de leur faire sortir ce qu’ils ont dans les tripes.
GANDHI
Pierre RABHI
Ivan ILLICH, Paolo FREIRE, Don Elder CAMARA,
des architectes comme : Aldo VAN EYCK, Giancarlo di CARLO, Christopher ALEXANDER
Ignacy SACHS
"Ignacy Sachs est un des socio économistes innovant. Connu dans le monde entier, il est l’un des premiers à avoir travaillé au concept de l’éco-développement, une croissance économique au service du développement social, respectueuse de la nature.
Ses travaux l’ont conduit à participer aux grandes rencontres internationales sur le sujet et à collaborer avec de nombreuses organisations internationales. Refusant tout dogmatisme, il est sur la troisième rive, celle de l’expérimentation réaliste et prudente, celle des solutions imaginatives et concrètes
Les années USA
Comment évoquer mes premières années là-bas ? Je me souviens avoir pris du retard à l’école. Mais avec la langue, c’est allé très vite. Il a fallu également que je me mette au sport. Le samedi, on allait au football américain. Dur. Je n’étais pas à l’aise. Jamais je n’aurais pu être “one of the boys” (un de la bande). J’étais d’une grande pudeur. Je n’aimais pas parler de sexe, de tous ces trucs entre garçons. Nous habitions New-York City. Mon père était en Amérique du Sud pour le commerce du bois exotique, le balsa. Ma mère le rejoignait assez régulièrement. Mon frère Jean était dans l’armée, et Jacques en Équateur. Je n’y suis allé moi-même qu’une seule fois, à 18 ans. J’étais souvent seul. Je ne devais pas être si heureux que ça...
Nous vivions à Manhattan, dans un grand bâtiment de quatorze étages. Nous habitions au onzième. J’y suis resté de dix à vingt ans. L’été, j’allais en colonie de vacances. J’ai eu une expérience malheureuse avec les scouts, que je trouvais un peu trop militaires. Je me suis évadé. Alors mes parents ont essayé une autre formule, dans une colonie de vacances juive, dans le Vermont, où je me sentais bien et où je passais deux mois. On vivait à six garçons dans des maisonnettes en bois, avec un animateur. On travaillait le bois, la photo, on fabriquait un journal, on chantait. C’était très formateur, une manière d’enseigner fantastique.
Après la guerre, on est retourné en France à plusieurs reprises. Les gens étaient assez critiques avec les américains. “Toi l’américain” disait mon oncle. Il se moquait gentiment et je ressentais comme une réprobation. Je ne me sentais pas vraiment américain, ni français d’ailleurs. J’ai été éduqué à l’école américaine où il n’y a pas de compétition comme ici. Pas de bac. Pas de contrôle des parents. J’étais impressionné, chaque fois que je venais en France, par tout ce savoir, cette manière de parler des gens de mon âge, et je crois à ce jour être encore impressionné, voire agacé, par ceux qui débitent de la parole au kilomètre, qui ont un point de vue sur tout, qui n’en finissent pas d’argumenter. C’est un des aspects de la culture française qui me rebute le plus, cette manière de se mettre en avant, de parader avec les mots.
Enfant, puis adolescent, je ne me suis jamais senti “one of the boys”, effrayé par ce que représentaient la bande, l’armée, l’idée d’être dans le rang, etc. En tant qu’homme, je ne suis pas dans la représentation. J’ai même une certaine méfiance des mecs qui veulent à tout prix être des hommes, qui roulent les mécaniques, qui racontent des blagues cochonnes. D’ailleurs, j’en comprends une sur dix. Je suis très conscient qu’ici encore, je suis un petit juif qui habite ce lieu et qui l’habite autrement que mes voisins, avec leurs tentures, leurs meubles, leurs bibelots, leurs bonnes manières, leur façon de dire “c’est comme ça qu’on a l’habitude de faire”. Et pourtant, je ne me sens pas juif. Je suis juif culturellement, pas religieusement. On est juif parce qu’on nous a dit qu’on l’était. A la maison, mes parents ne célébraient aucune fête religieuse. Mais je vis ainsi, jusqu’à aujourd’hui, je me sens toujours être “le petit juif prêt à partir”.
Bien évidemment j'ai été marqué par un certain nombre de rencontres, de lectures, d’auteurs qui m’habitent encore aujourd’hui : Martin Buber ( “The future of man as man depends upon a rebirth of dialogue”, cette phrase pourrait servir d’exergue au livre ), Emmanuel Levinas, Ivan Illich, Schumacher, un “alter mondialiste” avant la lettre, partisan d’une technologie à l’échelle humaine qu’il développe dans son ouvrage “Small is beautiful”. Je relis en ce moment un livre de Leibowitz, “Israël et le judaïsme”, et puis Winnicott, Wilhelm Reich.
Je me souviens avoir été très impressionné, quand j’avais 20 ans, par un livre écrit par la fille de Marshall McLuhan ("the medium is the message", qui avait elle aussi juste ces 20 ans, sur ce que nous avaient transmis oralement les Indiens, à savoir que la terre ne nous appartient pas et qu’il est surprenant que les européens brûlent la terre pour en accroître le rendement, alors qu’en réalité ils ne font que l’appauvrir, etc.
Plusieurs fois, j'ai eu des velléité d’aller à la synagogue, sans jamais y parvenir. J’ai fait partie d’un mouvement un peu œcuménique, "the Ethical Society" où je rencontrais Ruth, qui rassemblait des gens de différentes origines et religions. C'était à la fois le lieu de soirées de groupes de discussion sur les problèmes et situations contemporains, toujours suivi du plaisir d'un bonne heure "folk dancing".
Puis à Columbia, où Ruth, compagne puis femme, était également étudiante (avant de s’inscrire à Harvard en Sciences de l’éducation) j’ai poursuivi mes études d’archi et j’ai bénéficié d’une bourse de l’UNESCO pour voyager un an en Europe, le voyage “initiatique” en Italie, Sicile, Grèce, à la découverte de l’architecture antique. Nous nous sommes mariés en Grèce. Ruth est américaine, de parents américains, mais de grands parents hollandais, russes. Toujours la même histoire... On avait en commun toute une éthique de vie, cette alternance de confiance et de non confiance en soi, ces moments de doutes et ce besoin d’engagement.
Ruth avait enseigné dans une école à New-York. On avait envie de “retrousser les manches” ailleurs. Je voulais aller au nord du Brésil d’abord, dans un pays où il y a des choses à faire, où un architecte peut être en prise avec des gens, et c’est finalement en Inde, où s’est présentée une opportunité, que nous sommes partis, avec Claudia, qui avait trois mois, dans un couffin. Mon père m’a dit que j’étais fou.
Le périple indien
C’est Doshi qui a été le déclencheur de mon voyage en Inde, à la suite d’une rencontre dans l’atelier de Louis Kahn, aux États-Unis. Doshi était un architecte indien mondialement connu qui avait travaillé avec Le Corbusier en Inde. Il venait proposer à Kahn de construire “l’Indian Institute of Management” et il a parlé aussi d’un projet d’Ecole d’architecture qu’il avait à Ahmedabad et qui m’a tout de suite accroché. J’ai écrit à Doshi, lui faisant part de mon souhait de le rejoindre en Inde. Il a mis un an à me répondre. Alors, en attendant, j’ai enseigné à l’Université de Yale, dans un département d’architecture. La réponse de Doshi a fini par arriver : “Viens, tu peux avoir un salaire indien”. Pour bénéficier d’une bourse américaine, il fallait présenter un programme. N’ayant reçu aucune information précise de Doshi sur le projet d’école, j’ai inventé un programme qui reprenait les principes de Geddes, selon trois coordonnées : folk, work, place ( les gens, le travail, les lieux.)
Dès notre arrivée en Inde, Ruth a commencé par donner des cours d’anglais et moi j’ai démarré l’enseignement à l’école d’architecture. Je me suis trouvé assez vite en désaccord avec Doshi sur sa manière de conduire les choses à l’école. Doshi papillonnait avec beaucoup de talent, et moi j’assurais le programme.
Doshi voulait tout de suite une bibliothèque avec des revues et des livres spécialisés, pour que les étudiants y puisent directement idées et inspiration. Moi, j’avais une autre approche, je privilégiais le terrain, le fait d’aller “dans la boue” comme j’aime le dire, dans les villages, voir comment les gens habitent et vivent. Mes étudiants, qui avaient seize, dix sept ans, et qui étaient tous de classe plutôt aisée, ne connaissaient rien de leur pays.
Parallèlement, j’avais créé un atelier et commençais à réaliser des projets. J’ai construit, entre autres, deux “mini-écoles” pour Ruth. La première était constituée de quatre poteaux en brique sur lesquels étaient tendues des nattes en bambou tressé. La deuxième était dehors, à ciel ouvert, sous les manguiers. On habitait dans une petite pièce. J’avais un bureau sans électricité où les chèvres entraient et sortaient comme chez elles. Un Afghan aux cheveux rouges était gardien de troupeau juste à côté. Un jour une grosse dame est venue me voir, j’avais peur qu’elle s’appuie sur la table qui n’était tenue que par des fils et que tout s’écroule.... Après un très bon début, le climat à l’école d’architecture, dont j’étais le directeur adjoint, s’est détérioré. L’école s’est enlisée dans un train-train quotidien, un enseignement plus traditionnel. Après l’avoir beaucoup critiquée, j’ai démissionné et décidé de créer une université d’été, qui a fonctionné deux étés de suite, en 1968 et 1969.
J’ai finalement beaucoup expérimenté en Inde, beaucoup appris.
J’ai beaucoup aimé vivre dans l’acceptation de ce qui se passe. En France, on est toujours en train de se plaindre d’une chose ou d’une autre, le temps, les pannes, les retards, on n’a aucune patience. En Inde, on n’a pas le choix, il faut faire et vivre avec, il y a tout un art de se débrouiller, et si l’eau s’arrête, on fait sans. On s’organise avec des seaux, des bacs, sans ameuter le voisinage, qui subit la même chose. On vit constamment dans ce mélange entre des choses très belles et le dénuement. A ce jour, quand j’arrose les plantes, j’adore que ça déborde et dégouline sur le sol. Je n’aime pas les choses trop bien léchées. Comme du déglingué poétique avec lequel on s’arrangerait mais qui peut s’échapper à tout moment. Il y a là l’idée de la mobilité, de l’éphémère, du non définitif, qui touche à une conception de la vie et que j’ai intégré à ma conception architecturale.
Dans l’Inde que j’ai connue, tout était ouvert, il n’y avait pas réellement d’intimité au sens où on l’entend en Occident. Il fait chaud, on ne peut pas rester enfermé dans une pièce, il faut que l’air circule. Je ne sais pas si cela m’a influencé, mais je n’éprouve pas le besoin d’intimité. Les femmes me le reprochent... Mais je crois que c’est plus profond. Il faut qu’une porte reste ouverte, c’est culturel pour moi, lié à cette idée d’avoir à fuir, par une porte dérobée, une sortie de secours. Je ne peux pas murer une porte, cela m’est “éthiquement” impossible. Dans tous mes projets, il y a toujours deux issues, mais c’est aussi pour faire entrer et circuler la lumière, le soleil, l’air, le vent. Je ne peux pas dessiner une maison avec le couloir et les chambres d’un seul tenant, il faut une circulation, une échappée. Parfois, c’est un défaut quand ça communique trop...
Pour le centenaire de Gandhi, j’ai eu l’opportunité de participer à un Musée sur son “constructive programme”, j’ai pu ainsi en étudier les grandes lignes : le rôle émancipateur de la femme, la notion d’autonomie (“self suficiency”) pour la survie quotidienne, qui donne à chacun sa dignité en tant que personne, la non-dépendance vis-à-vis du sel, les idées contemporaines d’économie d’énergie, de technologie, de développement durable (la collecte d’urine pour faire du gaz de chauffage par exemple). Cela aussi m’a marqué, cette école de la simplicité. Malheureusement j’ai quitté l’Inde avant que le bâtiment ne soit fini et pris dans les exigences de ma nouvelle vie en France, je n’y suis pas retourné pour son inauguration.
Je me souviens d’une histoire qui circule à propos de Patrick Geddes et que j’aimerais évoquer ici parce que c’est elle qui m’a poussé à aller en Inde. Une manière d’illustrer aussi comment éduquer, réveiller les gens en partant de leur façon de faire et de vivre.
C’était en 1918, Geddes voyageait en Inde, allait d’une ville à l’autre en faisant des propositions urbaines. Il y avait la peste à Indor. Geddes a utilisé la fête de Pâques pour faire passer un message. D’abord il a incité tout le monde à nettoyer la ville sur le trajet du défilé. Tout devait être propre pour la fête. Tout avait été prévu. Il y avait en tête de cortège des chars avec un grand rat, puis des chars explicatifs sur la peste, derrière suivaient les balayeurs avec leurs turbans, puis le Maharadjah, et Patrick Geddes, en dernier, pour fermer la marche...
Il y a cette histoire magnifique, et bien d’autres choses encore, sans oublier la “tulsi plant” - une plante à la fois médicinale et religieuse, qui soigne et symbolise le printemps - qui m’ont poussé là-bas...
L’Inde tient pour moi une place tout à fait à part, de par sa longue histoire, les siècles qui s’y catapultent dans le présent, les problèmes auxquels ce pays doit faire face, et puis, évidemment, à cause de Gandhi, car sans lui la voie aurait été toute autre : totalitaire, nationaliste, sectaire.
Ce choix tracé par Gandhi vers une société plus égalitaire et malgré les énormes difficultés et perpétuelles contradictions que cela représente, est néanmoins le seul qui permette de rechercher du sens, non seulement pour la société indienne mais pour les nôtres.
Gandhi disait que tous les hommes ne sont pas nés égaux, mais qu’on doit leur donner la possibilité de chances égales de se développer, de vivre, de s’épanouir. Ce qui constitue le point commun entre mes projets en France, à l’étranger et notamment en Inde, c’est qu’ils puissent renforcer cette égalité des chances, tant au niveau de l’architecture que de l’urbanisme.
Cela se traduit pour moi par la qualité des infrastructures, des espaces publics, des rues, des places, des espaces végétaux et aquatiques jusqu’aux plus petits recoins de l’habitat. En rendant accessibles les rives et les berges dela Seine aux abords de Paris, ou celles du fleuve Sabarmati à Ahmedabad, on redonne une liberté et un bien-être à tous les habitants. Le droit de circulation, de libre accessibilité aux richesses de la ville par des transports en commun dignes des plus beaux bâtiments est aussi une de mes préoccupations. Lutter contre la société à deux vitesses en donnant à tous les habitants un accès égalitaire à l’éducation, à la santé, à la culture dans des équipements publics de qualité est pour moi une question centrale de l’urbanisme.
Le retour en France
Quand je suis arrivé en France, j’ai senti que je n’étais pas “un produit français”, même si je parlais le français, qui est ma langue maternelle. J’avais accumulé des tas d’expériences ailleurs, j’étais un animal rare, atypique, c’est d’ailleurs pour cela que j’avais été engagé, mais finalement je n’ai pas su l’exploiter.
Et quand j’ai débarqué au Ministère et que j’ai eu à faire avec l’administration, je ne comprenais rien. Je devais faire partie d’une équipe pluridisciplinaire ( qui comprenait, autour de Jean-Paul Martin, jeune énarque, Gustave Massia, mathématicien, Jean-Paul Flamand, sociologue ) mais qui a été dissoute la veille de mon retour. Si bien que je me suis retrouvé terriblement isolé. Alors ils m’ont engagé comme conseiller dans le cadre de la réforme de l’enseignement de l’architecture. J’ai fait le tour de toutes les villes de France pour voir comment fonctionnaient les écoles municipales d’architecture en vue de les refonder en écoles d’Etat. J’étais vu comme l’oeil du ministère, j’avais un rôle officiel, alors que je n’avais rien de commun avec tout ça. Cela a été une période très dure. Je n’ai pas su capitaliser ma différence, et comme je ne suis pas quelqu’un qui en rajoute... On a failli aller à Grenoble, ou à Lyon, j’ai toujours regretté de ne pas l’avoir fait. Il vaut mieux être un grand poisson dans un petit bocal qu’un petit poisson dans un énorme aquarium. Mais j’ai finalement beaucoup appris. En trois ou quatre mois de terrain, je savais tout sur les écoles de France. J’écrivais des rapports sur la façon de remplacer les écoles d’architecture par des universités pluridisciplinaires, qui sont restés au fond des tiroirs...
Heureusement, j’ai eu la possibilité de créer “l’Antenne” de Cergy-Pontoise, un lieu en interface avec le monde extérieur, avec des rencontres, des stages, des chantiers sur la ville. Je n’ai pas su médiatiser cette expérience non plus. J’ai occupé des fonctions très différentes et intéressantes pendant cette période, enseignant engagé, architecte embarqué dans une démarche de participation avec les habitants, fondateur en 1970 d’un bureau pluridisciplinaire “Environnement et Comportement”, associé à Georges Maurios, architecte et Michel Herrou, psychosociologue.
1968/1969 c’était la remise en question des mandarins chez les étudiants contestataires, mais on continuait à construire des “barres”, moins imposantes qu’au début des années soixante, 1000 logements à la place de 2000 sur 200 mètres de long, ce qu’on appelait “les chemins de grue”. Grandes opérations de l’urbanisme d’après guerre où il fallait reloger, construire dans l’urgence... On faisait ça au moindre coût, on construisait des cités en série, avec une grue sur rail qui permettait de part et d’autre l’élévation des bâtiments et la distribution d’éléments préfabriqués. Les architectes ont joué le jeu, il y avait un consensus sur cette façon de faire du logement. Il fallait gagner le pari du confort pour tous les foyers modestes.
Je suis contre ce gigantisme, dont le prétexte, sous couvert d’égalitarisme social, est uniquement économique, et producteur, à long terme, de ségrégation sociale. Même chose avec les hôpitaux, l’école, l’énergie. Le trop grand est ingérable. Tous les livres d’Ivan Illitch parlent de cela. Le petit peut être beau et économique, comme l’écrit E.F. Schumacher dans “Small is beautiful”. Il y a des tas d’exemples qui le prouvent.